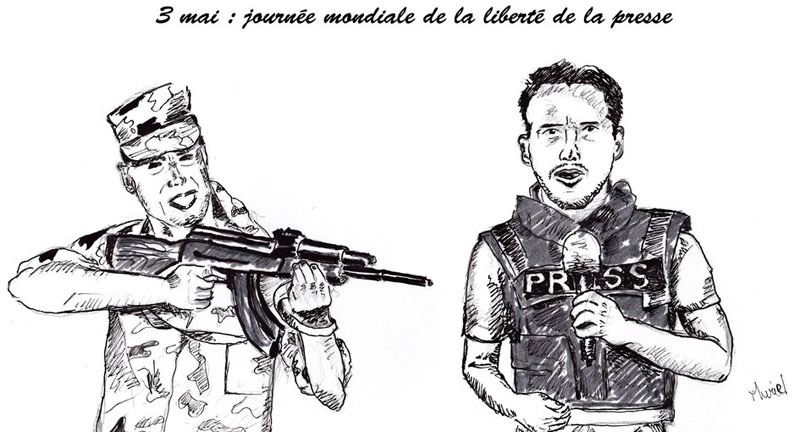Au conseil de sécurité de l’ONU, mercredi 12 avril 2023, le représentant permanent du pays auprès des Nations-Unies a répondu sèchement à tous ceux qui accusent l’armée malienne de violations des droits de l’homme. Il a pointé du doigt la responsabilité des forces françaises dans l’attaque de Bounty, tout en réitérant l’attachement des autorités maliennes de la transition au respect des droits humains.
Le Mali a rejeté d’un revers de la main les accusations françaises sur la violation des droits de l’homme perpétré à Moura, à l’occasion de l’examen par le Conseil de sécurité du rapport trimestriel du secrétaire général de l’ONU sur la situation au Mali. Le gouvernement s’engage à respecter les droits humains dans son combat inlassable contre le terrorisme.
Accusation de la France contre l’armée malienne
Les autorités maliennes ont profité de cette réunion du Conseil de sécurité pour dénoncer la rhétorique « accablante » de l’ambassadeur français, accusant l’armée malienne de graves violations des droits de l’homme à Moura.
« J’aurais aimé que l’Ambassadeur de France, s’il n’avait pas la mémoire sélective, dise à ce Conseil, qu’en janvier 2021, les Forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounty. J’aurais bien aimé, s’il n’avait pas la mémoire sélective, qu’il dise à ce Conseil les efforts qu’ils ont faits pour donner suite aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples », a indiqué M. Issa Konfourou.
Renforcer la présence de l’État sur le territoire
Le représentant permanent du Mali auprès des Nations-Unies a saisi cette occasion pour revenir surles victoires de l’armée malienne dans les théâtres d’opérations contre les terroristes. Selon ses précisions, « plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisées, leurs sanctuaires détruits et de grandes quantités de matériels de guerre saisies ou détruites. Aussi, durant la période sous examen, plusieurs dizaines de terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice, parallèlement à la reddition volontaire de nombreux terroristes dans les régions du Centre. »
Ces différentes opérations ont permis, comme le souligne le rapport du secrétaire général, daté du 30 mars 2023, « de renforcer la présence de l’État sur le territoire, de lever le blocus et l’emprise terroriste sur certaines localités dans les régions du Nord et du Centre, et de favoriser la fourniture des services sociaux de base aux populations, y compris la réouverture de certaines écoles dans les zones encore affectées par l’insécurité. »
Mise en garde des autorités maliennes
M. Konfourou rassure toutefois que « ces opérations sont menées dans le strict respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, conformément à nos valeurs humanistes ancestrales et par devoir envers nos populations. »Le diplomate malien rassure« que le Gouvernement continuera d’œuvrer inlassablement pour la protection et la promotion des droits de l’homme ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire ».
Toutefois, les autorités maliennes de la transition mettent en garde contre toute utilisation de la question des droits de l’homme à des fins politiques ou de déstabilisation.
Mohamed Camara