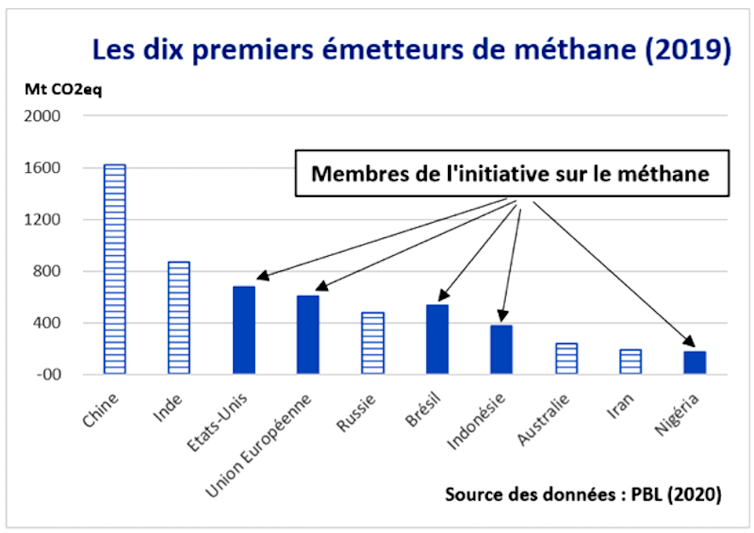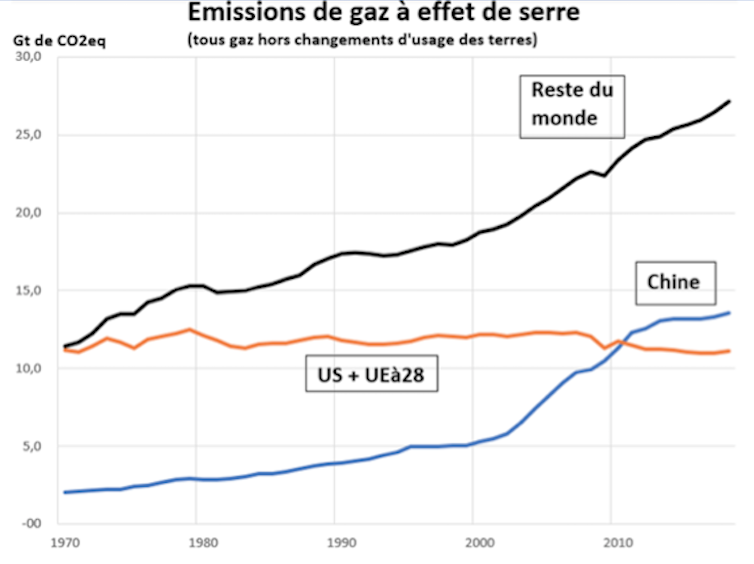Dr Aïcha Yatabary est consultante en santé publique et spécialiste des questions de santé durable, Approche One health. Dans cet article, elle réalise une étude scientifique sur l’utilisation du fleuve Niger comme source d’eau potable au Mali, mais aussi comme problème de santé publique et de développement durable (synthèse et propositions).
A/ État des lieux
Le fleuve Niger est le troisième d’Afrique par sa longueur (4200 km). Son bassin occupe une surface importante d’environ 1,2 million de km2 et est partagé par neuf états : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Tchad, qui constituent l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). C’est un fleuve important pour un grand nombre d’activités économiques et agricoles (culture du riz par exemple, confiée à l’Office du Niger au Mali), pour l’alimentation en eau potable et la production d’hydro-électricité.
Ce qui fait l’objet de notre étude, c’est l’utilisation du fleuve Niger comme source d’eau potable au Mali. En effet, grâce à ce fleuve, les eaux souterraines sont la principale source d’approvisionnement en eau du pays.
On note différents procédés pour cet approvisionnement : forage traditionnel (puits…) ou non (pompes…).
Cependant, malgré la création de réseaux d’adduction d’eau potable à partir des années 1990, seule une faible proportion de la population malienne bénéficie d’eau potable à partir du robinet.
Quels sont les défis auxquels les autorités maliennes sont confrontées pour la fourniture en eau potable et la gestion du fleuve Niger ? Quelles propositions pouvons-nous faire ?
I- La pollution du fleuve du Niger et les maladies de l’eau
Au Mali, seulement deux tiers de la population a accès à l’eau potable (ministère de l’énergie et de l’hydraulique du Mali, 2018).
Cette difficulté d’approvisionnement en eau potable, couplée à l’augmentation de collections d’eau insalubre, conduit à la prolifération de maladies dites de l’eau sale : paludisme, choléra, bilharziose, fièvre typhoïde, méningite, poliomyélite, qui ont une prévalence élevée au Mali et sont responsables d’un fort taux de mortalité et de morbidité.
Ainsi, on note un taux de mortalité et de morbidité élevés parmi les populations de la vallée du fleuve Niger, tout comme au sein de celles des zones humides de la région soudano-sahélienne, à cause des habitudes des populations liées à l’utilisation du fleuve Niger (consommation directe de l’eau du fleuve, défécation sur les berges du fleuve, etc.), les exposant aux maladies de l’eau sale. La diarrhée, à titre d’exemple, est la première cause de mortalité infantile au Mali.
Exemple de Mopti. Dans cette région où la vie des populations est principalement organisée autour du fleuve Niger (activités de pêche, de navigation, etc.) le choléra est endémique à poussée saisonnière.
La mortalité infantile est de 325 pour mille, élevée surtout à cause des diarrhées occasionnées par la consommation d’eau non potable, contre 237 pour mille à l’échelle nationale (IRD, 2007). N’oublions pas la malnutrition chez les enfants occasionnées par ces diarrhées dues à la consommation de l’eau sale.
II – L’assèchement, l’ensablement, l’envasement du fleuve Niger et le déficit d’eau potable
Ces phénomènes sont aussi bien les conséquences des activités de l’homme que du réchauffement climatique.
B/ Diagnostic
-Une pollution due à diverses activités industrielles, minières, agricoles, urbaines
-Un système d’assainissement défaillant
-La prolifération végétale sur le fleuve
-Les conséquences du réchauffement climatique
-Construction de barrages
I/ Pollution
1- Pollution industrielle
M. TOURE (1986) a montré que quelques indicateurs de pollution présentaient des valeurs élevées dans les rejets de certaines usines (ITEMA, TAMALI et UMPP) qui sont mises en cause dans la pollution du Niger. Ces activités industrielles entrainent le rejet dans le fleuve Niger de mercure, de cyanure, entre autres, qui sont de véritables poisons.
Exemple : Incident dans le retraitement des eaux usées de l’HUICOMA à Koulikoro : cette usine assure normalement le retraitement partiel des eaux usées et un incident dans ce retraitement a conduit à une pollution du fleuve Niger par des rejets ; les pêcheurs ont pu constater la mort de poissons suite à cet incident qui a fait encourir également des risques graves pour la santé de l’homme.
2- Pollution due aux activités minières
Sur tout un parcours de Djoulafondio, dès son entrée au Mali, à Labbézanga (frontière nigérienne), les sources de pollution sont autant diversifiées que disproportionnées et l’exploitation aurifère y occupe une place prépondérante, principalement l’orpaillage par dragage dans le lit des cours d’eau (RAPPORT SUR L’ÉTAT DU FLEUVE NIGER AU MALI, 2018).
3- Pollution due aux activités humaines
-Les sources diffuses de pollution sont au Mali, à Bamako, essentiellement d’origine agricole, liées à l’utilisation d’engrais et de pesticides en agriculture et à l’augmentation du cheptel.
-Secteur artisanal très actif : selon la chambre de métier, en 2015, plus de 1500 teinturiers exercent dans le district de Bamako dont plus d’une centaine le long des cours d’eau. Malgré les textes législatifs en matière de gestion des ressources en eaux, les populations continuent à y pratiquer des activités comme la teinture et la lessive. Certaines teinturières pratiquent directement dans le fleuve.
Les rejets d’effluents de teinturerie et de lessive dans le fleuve Niger sont importants, surtout qu’en général les activités sont menées directement dans le lit du cours d’eau. La pollution des eaux est constatée au niveau de tous les sites aménagés ou non. Au niveau des sites aménagés la pollution par la teinture se faisait sentir surtout que l’autoépuration n’était pas assurée partout.
-Défécation en plein air
Causée par un déficit de latrines, surtout en zone rurale, cette problématique entraine une contamination bactériologique du fleuve Niger, causant des maladies de l’eau sale, dont celles que nous avons évoquées précédemment. Ce fléau est connu plus largement sous le terme de péril fécal.
-Au niveau des centres urbains comme Bamako, le fleuve Niger qui est également utilisé pour le loisir, la pêche et le transport, comme dans les zones rurales est littéralement devenu le dépotoir et le milieu récepteur des déchets solides et liquides.
-L’exemple des abattoirs est prégnant, puisqu’ils constituent une importante source d’utilisation et de pollution du fleuve Niger.
-Par ailleurs, B. DIARRA (1985), a montré que les eaux de puits traditionnels des quartiers périphériques de Bamako et celles des puits situés près du fleuve, étaient polluées.
II/ Système d’assainissement défaillant
1- Défi de la croissance démographique et de la gestion des déchets
Migration vers le sud exacerbée par la crise sécuritaire au nord.
2- Insuffisance, mauvaise conception et manque d’entretien des infrastructures d’assainissement
– Bamako ne dispose pas d’un système d’égout pour une collecte adéquate des eaux usées
-Aucune station de traitement des eaux usées produites dans la ville n’existe à l’exception d’un système de lagunage fait de bassins qui reçoivent les effluents de quelques unités industrielles dont le traitement n’est pas assez efficace.
Les eaux usées brutes de toutes natures de la ville de Bamako se retrouvent donc déversées directement ou indirectement dans le fleuve Niger par ruissellement diffus ou à travers des rejets ponctuels de collecteurs des eaux pluviales.
-Prolifération des dépôts anarchiques des déchets solides qui sont charriés dans le fleuve contribuent à le polluer grandement.
-Absence de station de traitement des boues de vidange pour Bamako qui sont déversées dans la ville et ses périphéries de façon illicite ou incontrôlée occasionnant une contamination du fleuve par les collecteurs des eaux pluviales et/ou par les ruissellements pluviaux (BA, 2018).
III/ La prolifération de plantes aquatiques envahissantes
– La jacinthe d’eau forme rapidement un tapi flottant dense, capable de boucher les canaux d’irrigation et d’approvisionnement en eau, de bloquer le fonctionnement des centrales hydrauliques et de limiter le transport sur le fleuve (ADAMOU et al., 2015).
-Les nattes flottantes de jacinthe d’eau réduisent également le niveau d’oxygène dissous à un taux insupportable pour de nombreuses espèces (plantes, amphibiens, batraciens).
– Pendant l’étiage, la plante provoque l’eutrophisation des eaux sur certaines portions stagnantes réduisant considérablement la qualité de l’eau (MEAM, 2010). Les nattes de jacinthe hébergent aussi des vecteurs de maladies (bilharziose, choléra, paludisme, filariose, etc.). En outre, lorsqu’elle meurt, en plus de participer au comblement des fonds, elle libère dans le milieu tous les polluants toxiques (métaux lourds) qu’elle a eu à piéger.
IV / Impact du changement climatique
Le réchauffement climatique a un impact sur la santé globale par le biais de deux dynamiques liées à l’eau :
-Les précipitations accrues dans certaines régions favorisent la prolifération de maladies hydriques (maladies dites de l’eau sale comme le choléra, liée à la perturbation de systèmes d’épuration et de traitement de matières fécales et les maladies comme le paludisme dont les collections d’eau offrent un milieu favorable à la prolifération des vecteurs), selon le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement)
Pendant la crue (saison des pluies), le niveau de la pollution du fleuve Niger devient plus élevé à Bamako. En effet, différents déchets sont entrainés jusqu’au fleuve par les eaux de pluie :
– Ceux issus de l’activité industrielle (pollution chimique)
-Ceux issus des entrepôts qui stockent les produits agricoles (pesticides, hydrocarbures, etc.)
-Ceux issus des ordures ménagères, eaux grises, défécation en plein air, etc
Cette pollution du fleuve a des répercussions sur la santé des populations qui s’approvisionnent directement dans le fleuve en eau et en ressources halieutiques (maladies de l’eau sale…)
-La sécheresse entraîne les difficultés d’approvisionnement en eau potable, à cause de la diminution des sources d’eau profondes, toujours selon le PNUE.
Pendant l’étiage, la pollution devient plus importante, l’eau du fleuve presque stagnante, subit une forte activité des populations et des usines. En plus de ces spécificités, l’eau courante du fleuve subit une dégradation progressive de l’amont vers l’aval (M. SIDIBE, 1992, p.84).
V/ Impact des barrages hydrauliques sur la disponibilité
Les barrages qui sont construits pour des exigences économiques, ont des conséquences sur la disponibilité de l’eau potable, qu’ils compromettent parfois par :
-Evaporation des eaux accumulées
-Envasement provoqué par le faible débit de l’eau, qui altère la qualité de celle-ci
-Eutrophisation avec pour conséquences la prolifération végétale, la baisse de la quantité d’oxygène et le déséquilibre de l’écosystème concerné.
Ce déficit d’eau du fleuve entraine une pénurie d’eau potable avec les conséquences sur la santé évoquées au point précédent.
C/ Propositions
De façon générale, il faut :
-Mettre en place une gestion intégrée, systémique et transversale qui inclue les ministères de la santé, de l’hydraulique et de l’assainissement
-Augmenter le budget de l’Etat dédié à l’eau et à l’assainissement ( qui permettra de réaliser des économies induites par la baisse de la prévalence des maladies hydriques)
-Renforcer la coopération sous-régionale pour la gestion du fleuve Niger (Autorité du Bassin du Niger)
-Fédérer les initiatives privées et publiques relevant du domaine de l’assainissement et de la fourniture d’eau potable
-Eduquer pour le changement de comportement
I/ Contre la pollution du fleuve Niger
1-Industrielle, minière
– Renforcer la législation pour la protection de l’environnement
– Notion de crime écologique visant la production de déchets industriels et issus de l’activité minière
2- Agricole
-Prévention des risques, approche intégrée.
3- Pollution liée à l’activité humaine
-Construction de sanitaires, surtout en zone rurale, pour lutter contre le péril fécal
-Adapter les activités artisanales des teinturières aux exigences de protection de l’environnement et du fleuve Niger
II/ Contre le système d’assainissement défaillant
– Améliorer le système d’assainissement des eaux usées, en améliorant le nombre, la qualité et l’entretien des infrastructures
* M. SANOGO (1985) a proposé la méthode du lagunage naturel dans la lutte contre la pollution du Niger par les eaux usées de Bamako.
* Cart’eau (2020), propose :
• Mettre à jour ou mener d’études approfondies sur le système de gestion actuel des déchets solides et liquides de la ville de Bamako ;
• Affecter des zones foncières sécurisées et implantées des décharges de transit sanitaires pour les déchets solides, de décharges finales d’enfouissement de ces déchets, d’une station de traitement de boues de vidange et d’une station de traitement des eaux usées de la ville avant leur déversement dans le Fleuve Niger ;
• Former des ingénieurs de l’environnement pour la conception et la gestion des ouvrages précédemment citées ;
• Exploiter le potentiel des ressources des déchets (eau, gaz, engrais, etc.) en recouvrant et valorisant ces ressources;
• Favoriser l’émergence d’une véritable industrie de la gestion des déchets qui créera d’emplois stables à travers un entrepreneuriat social formel et soutenu par une volonté politique réelle
– Aligner la politique d’urbanisation de la ville de Bamako sur les exigences environnementales
* Intégrer les stratégies qui visent à lutter contre le changement climatique dans les politiques de développement et d’urbanisation
III/ Contre la prolifération de végétaux aquatiques
– Lutter contre l’eutrophisation du fleuve
-Limiter au mieux les conséquences de l’étiage
-Lutte mécanique par extraction et trituration
IV/ Contre l’impact du réchauffement climatique sur le fleuve Niger
– Former les populations et surtout les femmes à des techniques agricoles de conservation (qui réduisent les besoins en eau et en engrais) et favorables à l’environnement. Dans ce cadre, il serait intéressant d’envisager cette politique que l’on appelle l’Adaptation à Base Communautaire (ABC) des populations au réchauffement climatique.
-En termes de transfert de technologie, agir dans le sens de l’employabilité et de l’entrepreneuriat dans les « métiers verts », destinés à la protection de l’environnement (production et distribution d’énergie et d’eau, assainissement et traitement des déchets, professions transversales, comme les techniciens de la qualité de l’air, professions liées à la protection de la nature) ainsi que dans l’économie verte
-Favoriser le recyclage, surtout des déchets plastique
-Investir dans la culture de plantes qui favorisent la bio-séquestration du carbone
V/ Problématique des barrages hydrauliques
-Harmoniser les exigences économiques avec les réalités environnementales, dans un souci de développement durable.
Références bibliographiques
ADAMAOU R., ALHOU B. et, GARBA Z., 2015, « Impact de la pollution anthropique du fleuve Niger sur la prolifération de la jacinthe d’eau », In Journal des Sciences, Vol. 15, N° 1, 15 p.
BA Sidy. (2018). Le péril de la pollution sur le Fleuve Niger. Éditions l’Harmattan, Paris, France.
DIARRA B., 1985, « Contribution au contrôle de qualité de l’eau dans certains quartiers périphériques de Bamako », Thèse de pharmacie, Bamako
ÉTUDE CART’EAU, 2020, « Cartographie du Réseau d’Égout de Bamako et Évaluation des Deversements des Eaux Usées de la ville dans le Fleuve Niger », Rappport technique, Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA), Mali, 52p.
SANOGO M., 1985, « Contribution à l’analyse physico-chimique des eaux usées des villes de MEZE et de BAMAKO », Étude de l’épuration par lagunage naturel, Bamako.
TOURE M., 1986, « Étude de quelques aspects de pollution de l’environnement et des risques d’exposition aux produits toxiques dans certaines unités industrielles de la zone industrielle de Bamako », Thèse de pharmacie, Bamako
Références bibliographiques
1) Diarrhée, première cause de mortalité infantile au mali :
(en) « Water quality and waterborne disease in the Niger River Inland Delta, Mali: A study of local knowledge and response », dans Health and Place, vol. 17(2), 2011, pp. 449-457.