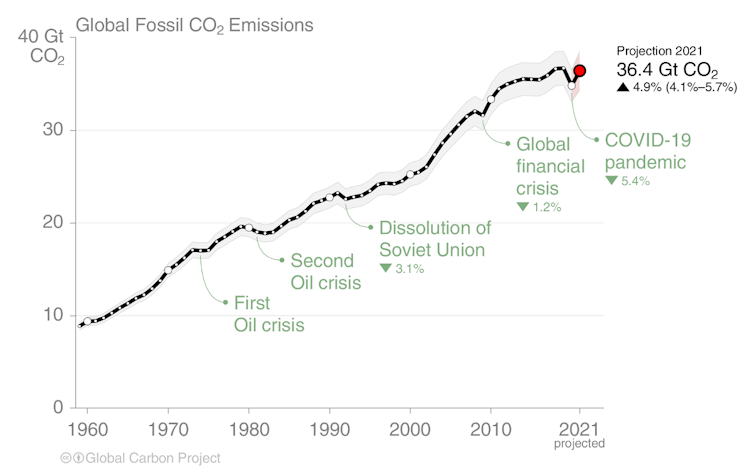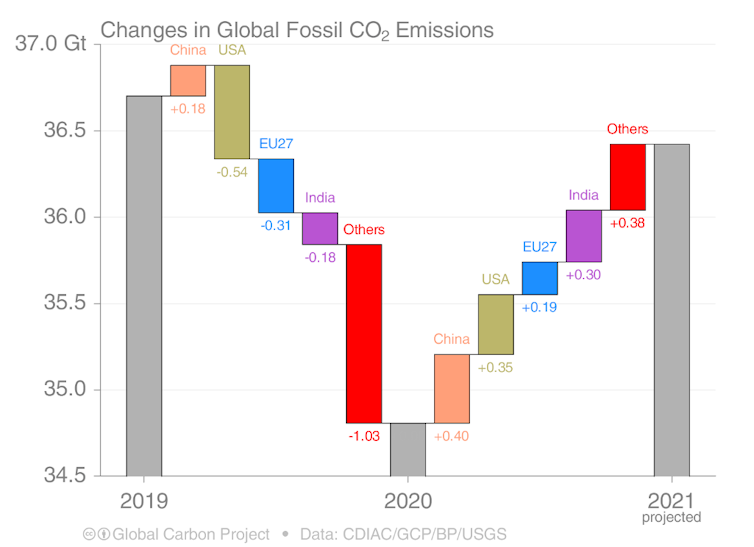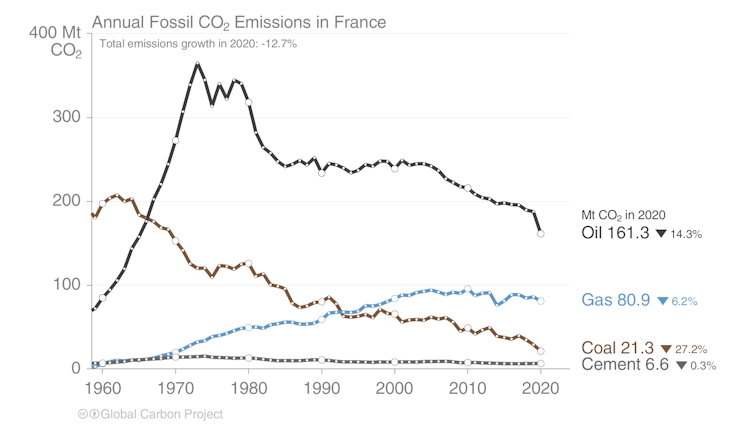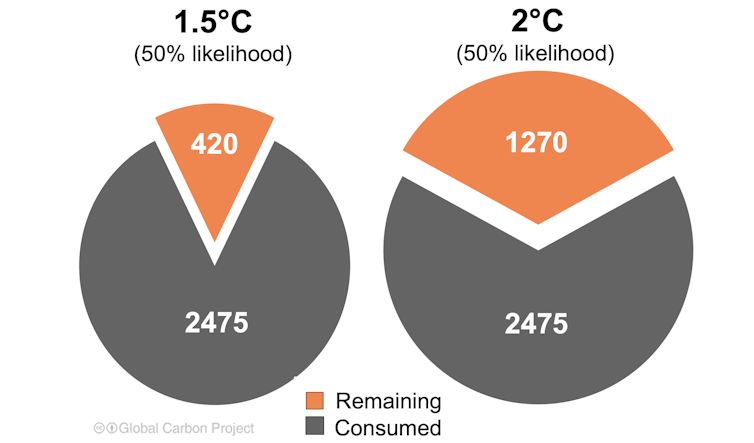L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) est l’une des plus vieilles organisations intergouvernementales en Afrique, née en 1964 sous le nom de Commission du Fleuve Niger. Pour Dr Aïcha Yatabary, avec une coopération encore plus solidaire et au regard de ses résultats au Mali, l’ABN pourrait être un instrument efficace d’intégration pour les populations de cet espace géographique et de mise en œuvre de politiques communes de développement pour le Bassin lui-même.
Neuf États, un destin commun, autour du Fleuve Niger : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Tchad. Cette gestion commune du fleuve, en tant que ressource hydraulique, est l’une des meilleures au monde comme coopération intergouvernementale autour de la gestion fluviale. Les pays membres de l’ABN se sont toujours caractérisés par leur solidarité à toute épreuve.
Face à de nombreux défis comme la production d’énergies renouvelables pour des exigences d’industrialisation et d’électrification, la pénurie d’eau qui s’annonce dans cette zone du Bassin du Niger, exacerbée par le réchauffement climatique et le risque d’insécurité alimentaire ainsi que de conflits qu’elle pourrait entraîner, face aussi au rejet de la Cédéao [Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest] par de nombreux pays, il serait temps de renforcer les pouvoirs de l’ABN autour de la coopération intergouvernementale et de lui apporter un souffle nouveau.
De nombreux avantages
Cette coopération présente déjà de nombreux avantages :
- Renforcer les liens culturels des nombreuses populations qui se partagent ce fleuve
- Gérer de façon durable l’eau et ses ressources, pour faire face à la pénurie d’eau et aux défis du réchauffement climatique, qui engendre de nombreuses conséquences comme les conflits intercommunautaires
- Répondre aux exigences de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, pour garantir la sécurité alimentaire des populations.
- Répondre à la question de la fourniture d’eau potable, qui est un axe important de la santé, surtout la santé infantile
- Produire une énergie renouvelable pour répondre au défi de l’industrialisation de façon durable, et de l’électrification : le défi de l’industrialisation (dans le cadre de la transformation du coton au Mali, par exemple), ne pouvant être relevé sans la viabilité d’une source d’énergie durable et pérenne ; et sans une certaine indépendance vis-à-vis de certains voisins
- Répondre de façon idoine à la quête de prospérité, de santé et de développement de façon plus générale, des populations qui se partagent ce fleuve et au-delà de celles-ci, des populations du Bassin du Niger.
Exemple d’une gestion vertueuse
Chargé de la gestion de la zone intérieure du Delta du Niger pour tout ce qui concerne les activités liées principalement à l’agriculture, l’Office du Niger au Mali a été décrit comme une success story pour ses résultats de 1980 à 2006. Cette entreprise parapublique met en relief l’importance des retombées d’une gestion vertueuse du fleuve Niger.
En effet, l’eau est une ressource importante pour l’essor économique et social d’une nation. Un pays qui manque d’eau est un pays qui ne peut ni nourrir sa population ni se développer, puisqu’il est largement admis qu’en dessous de 1700 m3/a, le développement d’une société est contraint par un problème d’accès à l’eau (Lasserre et Descroix, 2002). Les retombées de la bonne gestion du fleuve Niger sont nombreuses au Mali :
- Garantir la sécurité alimentaire des populations grâce à la culture du riz et la fourniture d’eau potable pour le cheptel : les besoins nutritionnels des populations de la zone de l’Office du Niger au Mali sont satisfaits à 90 % en moyenne, dans un contexte où les populations de la zone de l’Afrique de l’ouest font face à une crise alimentaire et nutritionnelle grave
- Augmenter le niveau de vie des populations grâce à la culture du riz et au commerce de celui-ci (les populations de cette région ont un revenu supérieur à celles des autres régions)
- Essor économique de la région, de façon plus large
- Amélioration de la santé des populations grâce à l’amélioration de leurs conditions de vie et leur état nutritionnel.
Instrument efficace d’intégration
Au vu de ces résultats et de la solidarité qui a toujours existé entre les neuf pays membres de l’ABN, nous pouvons sans hésitation affirmer que l’ABN pourrait être un instrument efficace d’intégration pour les populations de cet espace géographique et de mise en œuvre de politiques de développement communes pour le Bassin du Niger.
Au-delà de la gestion fluviale commune de la plus grande artère fluviale d’Afrique de l’Ouest, la coopération entre les pays membres de l’Autorité du Bassin du Niger pourrait aussi tourner autour d’autres axes comme le secteur économique (commerce), technologique, le domaine culturel et le maintien de la paix.
Le panafricanisme de demain se construit déjà autour du fleuve Niger. Le réchauffement climatique avec son corollaire de conséquences désastreuses est là. Nous devons donc nous mettre ensemble. Il y va de l’avenir d’environ 200 millions de personnes qui peuplent le bassin du Niger. Les défis sont nombreux, mais pas insurmontables.

Dr Aïcha Yatabary est médecin de formation, consultante en santé publique à Paris, en France. Elle est la présidente de l’association Femmes Santé Solidarité Internationale. Elle est auteure du livre « Afrique, développement durable et coopération internationale » (Harmattan Côte d’Ivoire) et du roman « Le Banquet des marabouts ».