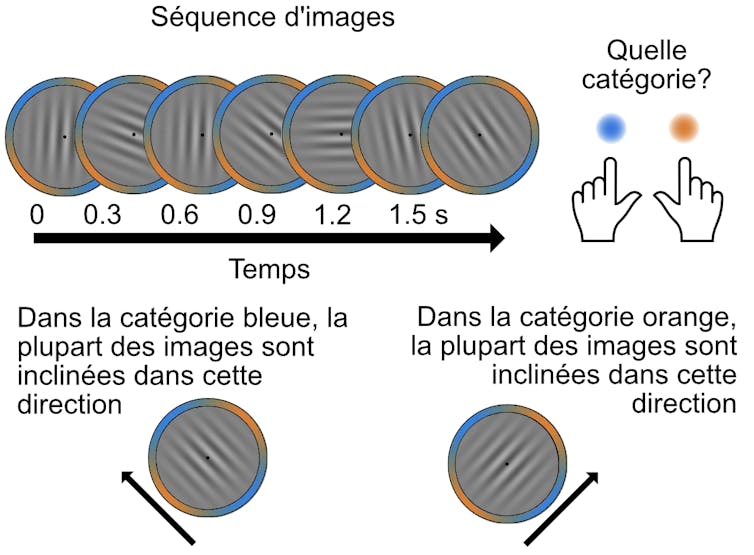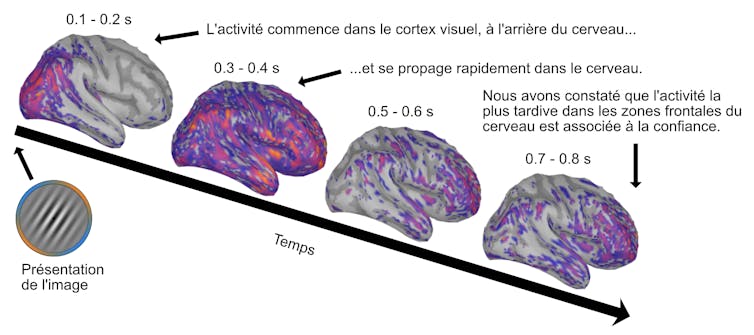Dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle et des débats sur de nouvelles orientations en termes de sécurité et de partenariat, le Mali a célébré son 61e anniversaire d’indépendance, ce mercredi 22 septembre 2021. Analyse.
Le Mali a célébré, sans faste, la date qui commémore son accession à l’indépendance. Cette commémoration du 22 septembre, qui est une occasion de rendre hommage aux pères de l’indépendance, a donné lieu à des défilés militaires, des chants et danses populaires, au cours desquels le drapeau malien est arboré et magnifié partout dans le pays.
Des constats partagés
Pourtant, la situation sécuritaire, socio-politique et institutionnelle du pays n’est pas assez propice à la fête. L’état de santé du pays est assez alarmant. Le Mali va de mal en pis. Les Maliens vivent la peur au ventre, au jour le jour. Le président de la transition, lors de son adresse à la Nation, à l’occasion de ce 61e anniversaire d’indépendance du pays, a d’ailleurs fait mention de la situation du pays.
La sécurité, la justice, l’égalité et l’autorité, sans lesquelles une république ne peut exister, sont absents sur une grande étendue du territoire. Le non-respect des droits fondamentaux de l’homme, le manque flagrant d’une éducation de qualité de masse et d’un soin de qualité pour tous, sans lesquels il n’y a pas de cohabitation pacifique, sont des constats partagés. Pire, les relations avec les partenaires internationaux, principalement la France, ne sont plus au beau fixe depuis que les militaires ont pris le pouvoir à travers deux coups d’État successifs en moins d’un ans.
Ingérence continuelle
Cet incident diplomatique rappelle la période qui a précédé les indépendances dans la plupart des pays francophones indépendants. Après 61 ans d’indépendance, l’ingérence continuelle des partenaires internationaux dans les affaires du Mali prouve que la quête de la liberté et d’auto-administration, qui avait été exprimée et obtenue en principe par les peuples, n’a pas été acquise au sens propre du terme.
Le débat et l’agitation des partenaires du Mali après l’annonce d’un pourparler entre les autorités maliennes et une filiale du groupe Wagner montrent que le champ de manœuvre des autorités maliennes sur la gestion du pays n’est pas clairement défini dans le protocole d’accord passé entre ce pays et l’ancienne puissance colonisatrice.
Mieux, ces réactions montrent que le Mali n’est pas une république souveraine, mais plutôt suzeraine aux yeux des autorités françaises, au regard des décisions et déclarations de ses officiels après chaque décision des autorités maliennes. La récente venue de la ministre française de la Défense au Mali et ses déclarations en point de presse en sont la preuve.
Poser les bases de la refondation
Or, dans une république, la puissance de décision, s’agissant des questions d’intérêt général, appartient aux autorités légitimes. Le peuple est le plus habilité à s’opposer aux décisions de ses autorités sur ces questions.
Cette situation institutionnelle d’exception dans laquelle le Mali se trouve, après six décades d’indépendance et plus de trois décennies de pratique démocratique, doit être mise à profit par le peuple malien afin de poser les bases réelles de la refondation.
Face à ses multiples défis, prendre en main sa destinée est la seule option qui s’offre aux Maliens. La préoccupation de l’heure devrait être l’analyse minutieuse du plan d’action ambitieux de la transition, articulé autour de quatre axes prioritaires, et sa faisabilité dans le temps. D’autre part, se pencher sur l’impact de l’alternative que préconisent les autorités maliennes au départ des forces armées étrangères présentes sur le sol malien peut être assez bénéfique pour le Mali. Car l’indépendance n’est pas qu’un mot.
Mikaïlou Cissé
Les opinions exprimées dans cet article ne sont pas forcément celles de Sahel Tribune.