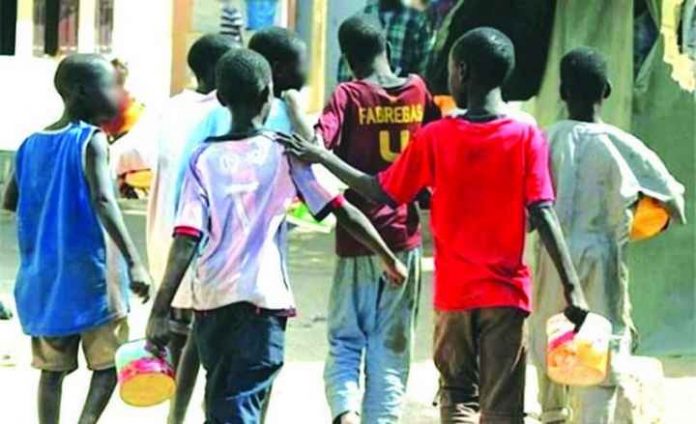Dans sa 21e édition du Classement mondial de la liberté de la presse, publiée ce mercredi 3 mai 2023, le Reporters sans frontières (RSF), révèle un véritable recul de la liberté de la presse au Burkina Faso aussi bien qu’au Mali. Deux pays gouvernés par des régimes de transition et confrontés à des crises sécuritaires.
Avec 80 journaux, 185 stations de radio, près de 30 chaines de télévision et 161 sites d’information, le Burkina Faso bénéficie d’un « environnement médiatique dynamique, professionnel et pluraliste », où la culture du journalisme d’investigation est assez répandue. Mais « la détérioration de l’environnement sécuritaire et politique a entrainé une augmentation de la pression extérieure et de l’autocensure », déplore le RSF. Dans le classement mondial de la liberté de la presse, le pays des « hommes intègres » se positionne au 58e rang sur 180 pays en lice, contre 41e en 2022. Ce pays était pourtant « considéré jusqu’à récemment comme l’une des réussites du continent africain pour la liberté de la presse ».
Selon le RSF, les nouvelles autorités du pays ont tendance à privilégier la lutte contre l’insécurité aux dépens de la liberté d’information. Les médias burkinabè évoluent « dans un contexte précaire, avec un faible lectorat et peu de publicité ».
Difficile de travailler hors de Bamako
Le Mali n’est pas épargné par ces problèmes. Avec près de 200 journaux, plus de 500 stations de radio et plusieurs dizaines de chaines de télévision le pays se classe 113e contre 111e en 2022, dans le Classement mondial de la liberté de la presse. Selon le Reporter sans frontière, « l’insécurité liée à la menace terroriste, conjuguée à l’instabilité politique […], compromet la sécurité et l’accès des journalistes aux informations », dans ce pays sahélien en proie à une crise multidimensionnelle, depuis plus d’une décennie.
Les médias et les journalistes maliens sont exposés à des menaces terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays, en raison des conflits intercommunautaires, de l’extrémisme et de la présence de groupes armés. « Travailler en dehors de la capitale, Bamako, est désormais extrêmement risqué pour les journalistes », explique le RSF.
Ce classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue les conditions d’exercice du journalisme dans 180 pays et territoires, explique qu’au Mali, la pression pour une couverture médiatique « patriotique » augmente. Le RSF estime que c’est seulement en théorie que « les journalistes et les médias sont libres de couvrir l’administration, et les médias privés sont relativement indépendants ». Les journalistes sont fragilisés par la situation politique et le durcissement des autorités au pouvoir.
Aussi, dans ce pays en crise, les médias et les journalistes ne sont pas à l’abri de l’influence et de la corruption. Ils « mènent une existence économique précaire ». Des difficultés « aggravées par une baisse des recettes publicitaires due à la pandémie et l’arrêt total des aides gouvernementales aux médias au cours des quatre dernières années », explique le RSF.
« Croissance de l’industrie du simulacre »
Selon Christophe Deloire, Secrétaire général de RSF, « le Classement mondial prouve l’existence d’une très grande volatilité des situations, avec des hausses et des baisses importantes […]. Cette instabilité est l’effet d’une agressivité accrue du pouvoir dans de nombreux pays et d’une animosité croissante envers les journalistes sur les réseaux sociaux et dans le monde physique. La volatilité est aussi le produit de la croissance de l’industrie du simulacre, qui façonne et distribue la désinformation, et donne des outils pour la fabriquer ».
Dans 118 pays, il est fait cas d’une implication des acteurs politiques « dans les campagnes de désinformation massive ou de propagande ; de manière régulière ou systématique ». La différence s’estompe entre le vrai et le faux, le réel et l’artificiel, les faits et les artéfacts, mettant en péril le droit à l’information, déplore le RSF.
La situation de la liberté de la presse est « très grave » dans 31 pays, « difficile » dans 42 et « problématique » dans 55, alors qu’elle est « bonne » ou « plutôt bonne » dans 52 pays. Autrement dit, les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisants dans seulement 3 pays sur 10, souligne le Reporter sans frontière dans son classement mondial de la liberté de la presse. Une 21e édition publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai.
La rédaction