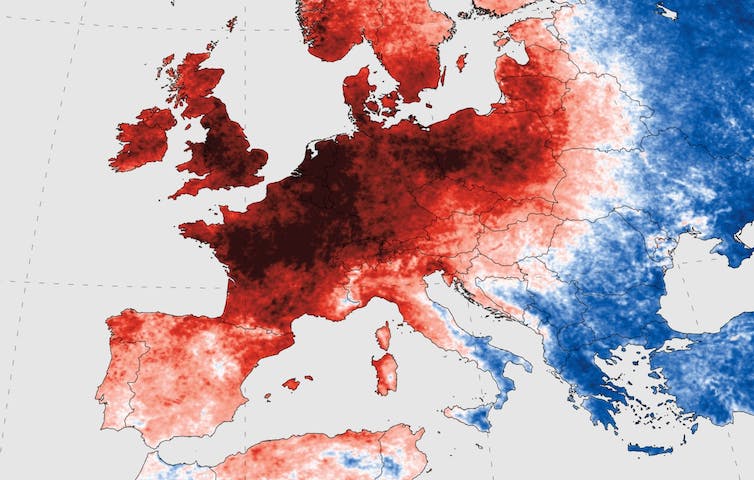Le mardi 22 aout 2023, le 15e Sommet des Brics s’est ouvert à Johannesburg, en Afrique du Sud, entre les cinq économies émergentes, notamment le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.
Après trois jours de Sommet, les leaders des cinq pays des Brics ont tenu un point de presse au centre de conférence de Johannesburg, pour faire le bilan de leurs délibérations. Il s’agit d’une première depuis le Covid-19, en 2020.
Plaider pour un rééquilibrage politique et économique
Lors de ce 15e Sommet des Brics, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé l’acceptation de six nouveaux pays dans le club, dont deux du continent africain. Il s’agit notamment de l’Argentine, l’Iran, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Éthiopie.
L’objectif des Brics est de plaider ensemble pour un rééquilibrage politique et économique face à un ordre international que ses leaders jugent dominé par l’Occident.
Cette décision historique va certainement transformer la dynamique au sein du groupe, avec des pays aussi variés en termes d’économies et d’affinités politiques. Il s’agit d’« un grand plaisir » pour le président brésilien, Lula. Une décision qui a été accueillie comme une preuve du renforcement d’un monde « multipolaire », pour le Premier ministre indien, Narendra Modi. Le président russe, Vladimir Poutine ainsi que Xi Jinping ont envoyé leurs félicitations aux nouveaux membres.
« Avec ce sommet, les Brics entament un nouveau chapitre », s’est félicité le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa.
Par ailleurs, l’adhésion de ces pays concernés à part entière aux Brics, prendra effet au 1er janvier 2024, a précisé le président sud-africain. Le nombre de pays membres du groupe passera ainsi de 5 à 11 à partir de la nouvelle année.
Le bloc, qui produit près d’un quart de la richesse mondiale (23 %) et rassemble 41 % de la population globale, revendique un équilibre économique et politique mondial multipolaire notamment au regard de l’hégémonie de l’Occident.
Réactions enthousiastes
Suite à cette décision, les pays concernés n’ont pas surtout manqué de manifester leur enthousiasme.
Pour la diplomatie iranienne, l’adhésion de l’Iran est un « succès stratégique pour la politique étrangère », a écrit sur X (ex-Twitter) le conseiller politique du président Ebrahim Raïssi. L’Éthiopie salue un « moment fort » pour le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique. « L’Éthiopie se tient prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère », a ajouté son Premier ministre Abiy Ahmed.
Bakary Fomba