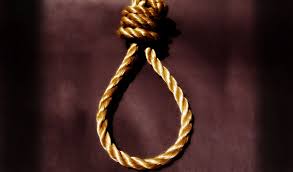Condamné à mort pour des publications critiques sur Facebook, Saber Chouchane, simple citoyen tunisien de 51 ans, cristallise les dérives d’un pouvoir de plus en plus répressif. Derrière l’affaire, un signal glaçant envoyé par le régime de Kaïs Saïed à une société civile déjà sous pression.
Saber Chouchane n’est ni militant politique, ni figure de la dissidence tunisienne. À 51 ans, ce père de famille sans emploi stable s’est fait connaître malgré lui par la sévérité de la peine prononcée à son encontre : une condamnation à mort, rendue le 1er octobre par un tribunal tunisien, sur la base de l’article 72 du Code pénal. Son tort ? Avoir publié, sur un compte Facebook au nom provocateur – « Kaïs Saïed l’infortuné » –, une série de messages jugés attentatoires à la forme du gouvernement.
Des limites de la liberté d’expression à l’ère numérique
Dans les faits, cette décision n’aboutira pas à une exécution : la Tunisie applique depuis 1991 un moratoire sur la peine capitale. Il n’empêche, la disproportion apparente entre l’acte – des publications à faible audience – et la sanction – la plus extrême prévue par le droit tunisien – a suscité un malaise dans l’opinion publique et dans certains cercles de la société civile.
Faut-il s’en étonner ? Pas forcément. Car cette affaire soulève une question plus vaste, et plus actuelle que jamais : celle des limites de la liberté d’expression à l’ère numérique. À une époque où les réseaux sociaux sont devenus des arènes incontrôlées, où chacun se fait tribun ou procureur, la tentation de l’outrance est constante. L’anonymat relatif offert par ces plateformes, la viralité des propos, la culture du clash – tout pousse à la démesure. Et parfois à la transgression.
Or, dans une République, la liberté d’expression n’est pas l’absence de règles. Elle s’exerce dans un cadre : celui de la loi, celui du respect dû aux institutions, et surtout à la fonction présidentielle. Dans toutes les cultures politiques, le chef de l’État incarne la continuité de la nation. En Afrique comme ailleurs, il est, qu’on l’apprécie ou non, une figure d’autorité, dépositaire d’une légitimité populaire, et à ce titre, il mérite respect. Non pas dévotion, mais retenue. Non pas silence, mais mesure.
La fermeté ne saurait remplacer la pédagogie
Cela ne signifie pas que toute critique devient sacrilège, ni que le citoyen doit se taire. Mais il y a, entre la liberté et l’invective, une frontière. Celle que Saber Chouchane, à sa manière, a franchie – peut-être sans en mesurer les conséquences.
Ce que cette affaire révèle, aussi, c’est la difficulté pour des systèmes judiciaires à s’adapter aux mutations de l’espace public numérique. Faut-il pour autant dégainer l’article 72 à la première incartade sur Facebook ? Probablement pas. À l’inverse, peut-on laisser se banaliser les discours de haine, les attaques ad hominem, les remises en cause violentes de l’ordre institutionnel ? Certainement pas.
L’équilibre est délicat. Il suppose, de part et d’autre, responsabilité. Responsabilité des citoyens dans leur expression, mais aussi responsabilité des juges dans l’application des peines. La fermeté ne saurait remplacer la pédagogie, ni la loi se substituer à la prévention.
Car au fond, ce que cette affaire nous dit, c’est que l’avenir du débat public – en Tunisie comme ailleurs – dépend moins des tribunaux que de notre capacité collective à réapprendre les règles élémentaires du vivre-ensemble numérique. Cela commence par un principe simple : toute liberté s’arrête là où commence la dignité d’autrui. Et cela vaut aussi, et peut-être surtout, lorsqu’il s’agit de celle du chef de l’État.
A.D
En savoir plus sur Sahel Tribune
Subscribe to get the latest posts sent to your email.