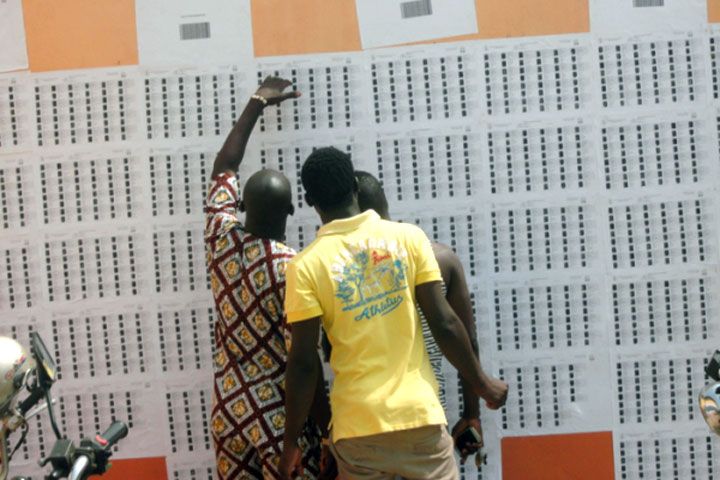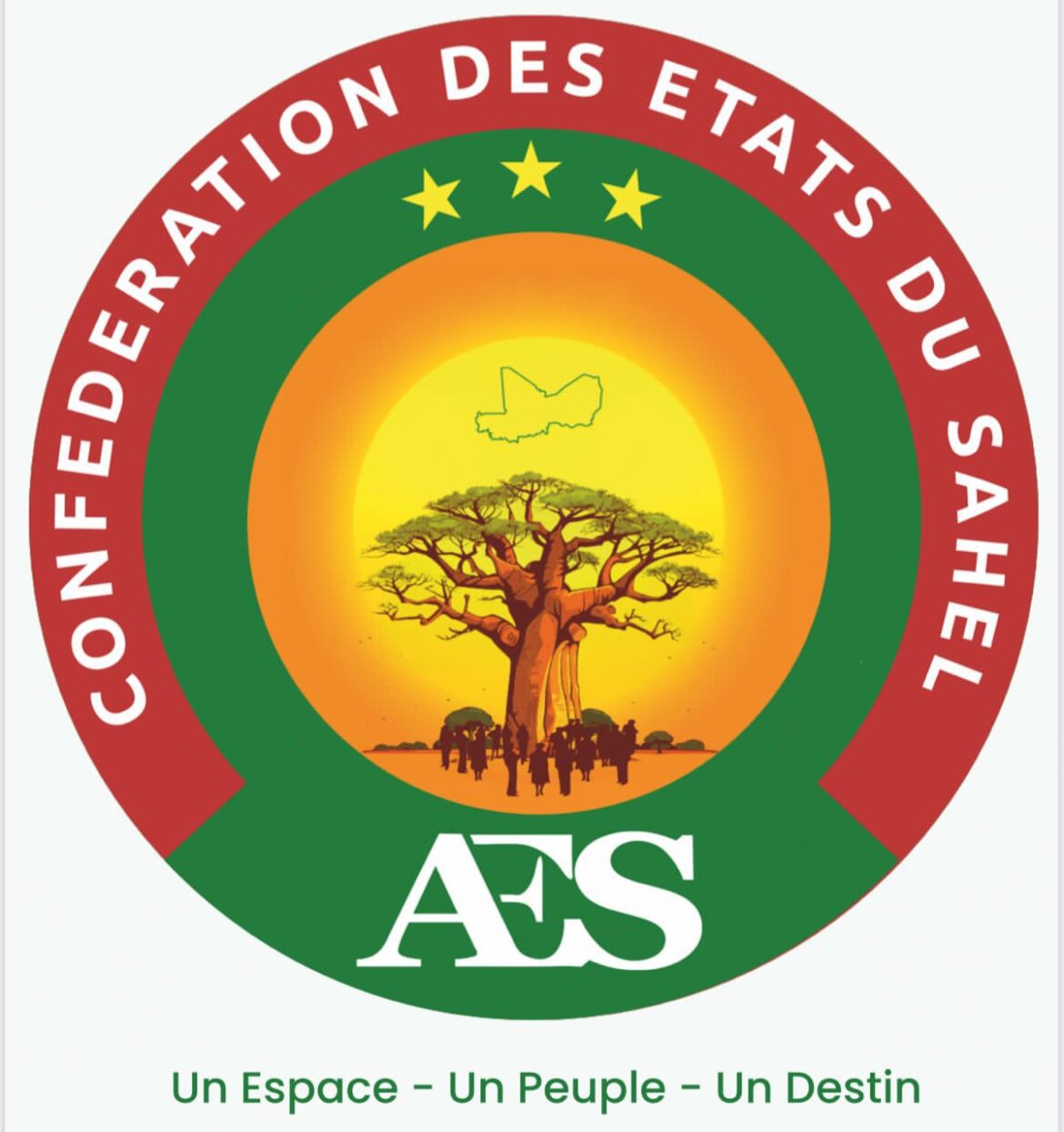La semaine écoulée a une fois de plus démontré l’engagement résolu des Forces armées maliennes (FAMa) dans leur mission de protection et de défense du territoire national. À travers une série d’opérations aériennes d’envergure, l’État-Major général des Armées a confirmé sa détermination à éradiquer les menaces terroristes qui continuent de semer l’insécurité dans plusieurs régions du Mali.
Les frappes aériennes menées les 27, 28 et 29 décembre 2024, dans les régions de Douentza et Kidal, illustrent la capacité stratégique des FAMa à identifier et neutraliser des cibles précises. À Dounkoye, dans la région de Douentza, l’élimination des occupants d’un pick-up menaçant les populations a été une action décisive pour protéger les civils face à l’insécurité grandissante. Ce même engagement s’est traduit par la destruction, dans la région de Kidal, de véhicules utilisés pour le transport de logistique et d’armes. Ces interventions démontrent la montée en puissance des capacités opérationnelles des forces maliennes, soutenues par une volonté inébranlable de garantir l’intégrité du territoire.
Une lutte indispensable
Le contexte sécuritaire du Mali demeure complexe, marqué par la persistance de groupes armés terroristes qui opèrent dans des zones reculées et difficiles d’accès. Ces groupes utilisent souvent des véhicules camouflés, comme cela a été observé à Al Ma Zakak et Tessalit, pour dissimuler leurs activités. En s’attaquant directement aux infrastructures logistiques et armées de ces ennemis, les FAMa privent ces groupes de moyens essentiels à leur survie.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de frapper l’adversaire. Ces opérations visent également à envoyer un message clair aux populations locales : l’État malien est présent, actif et engagé dans leur protection.
Les défis à surmonter
Si ces succès sont encourageants, ils ne doivent pas masquer les défis persistants auxquels le Mali fait face. La lutte contre le terrorisme nécessite une approche globale, combinant efforts militaires, stabilisation socio-économique et renforcement du dialogue entre les différentes communautés. La confiance des populations envers l’État est un facteur clé dans cette bataille, et cette confiance se construit par des actions concrètes, mais également par une communication transparente et régulière.
L’État-Major général des Armées a assuré que la traque des terroristes se poursuivra sans relâche. Cette détermination, combinée aux récentes réformes entreprises dans le cadre de la refondation de l’État malien, offre un espoir tangible de voir le pays retrouver une stabilité durable. Les FAMa méritent, à ce titre, le soutien indéfectible de toutes les composantes de la société malienne.
Alors que nous entamons une nouvelle année, ces opérations doivent nous rappeler que la sécurité n’est pas qu’une responsabilité des forces armées, mais une œuvre collective. Il appartient à chaque citoyen, acteur politique et institution, de contribuer à la paix et à la stabilité du Mali. La victoire sur le terrorisme ne sera totale que si elle repose sur l’unité et la résilience de tout un peuple.
Ibrahim K. Djitteye