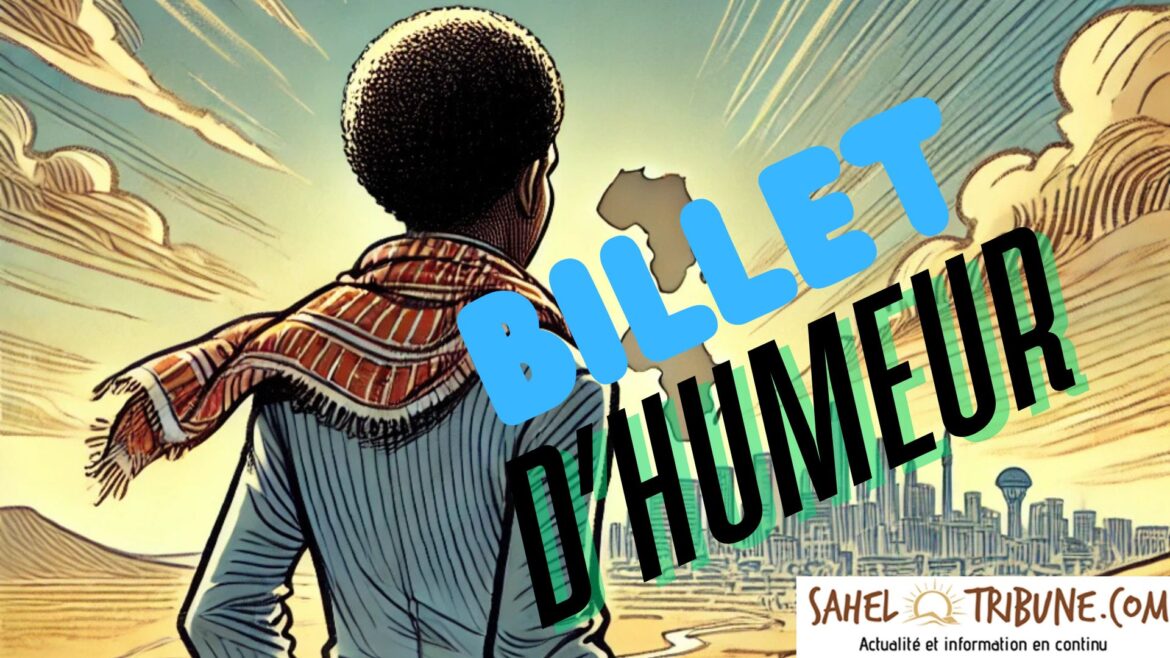Face au chaos climatique et à l’indifférence internationale, le Mali, le Burkina Faso et le Niger choisissent de tenir bon. Loin d’être les maillons faibles d’un Sahel en crise, ces États redéfinissent, à leur manière, les contours d’une souveraineté face à une menace silencieuse : le dérèglement climatique.
« C’est un horrible et incroyable charnier à ciel ouvert. Des morts et des mourants y sont entassés les uns sur les autres. Certains corps sont enflés au point d’éclater, d’autres se vident de leur contenu, entourés de membres et de chairs éparpillés que se disputent des vautours. »
Cette phrase, terrible, glaçante, n’est pas tirée d’un roman d’apocalypse. Elle est signée d’Amadou Hampâté Bâ, mémoire vive de l’Afrique sahélienne, témoin de la famine de 1914. Une famine née d’un hivernage raté, d’un été sans pluie. Un siècle plus tard, l’histoire, comme un relent de sable chaud et de poussière amère, semble bégayer.
Une menace permanente
Dans cette partie du monde que certains continuent d’appeler « bande sahélienne » comme on nomme un front oublié, le vent ne souffle plus comme avant. Il brûle. Il emporte les récoltes, fissure les terres, et s’infiltre jusque dans les fondations fragiles des États. Et pourtant, malgré le sable dans les yeux et l’indifférence dans les oreilles, certains gouvernements ont décidé de tenir.
Le Mali, le Burkina Faso, le Niger — trois pays souvent réduits à des acronymes de crise, à des titres d’alerte sur les chaînes d’info. Trois nations qui, ces dernières années, ont osé rompre avec l’ordre établi. On peut en discuter les méthodes, mais pas le diagnostic. Leurs peuples étouffaient sous un double joug — celui d’un terrorisme rampant, et celui, plus insidieux encore, d’un système économique et sécuritaire international aussi distant qu’inefficace.
Car pendant qu’à Paris ou à Bruxelles on découvrait, avec un temps de retard et une pudeur hypocrite, que le climat pouvait tuer, les villageois de Mopti, de Dori ou de Tillabéri le savaient déjà depuis longtemps. Chez eux, la météo n’est pas une rubrique. C’est une menace permanente. Des pluies qui inondent, quand elles ne se font pas attendre. Des récoltes qui disparaissent, des troupeaux sans herbe, des puits sans fond.
Et dans cet enfer lent, les États sahéliens ont choisi de ne plus tendre la main, mais de retrousser leurs manches. D’assumer leur solitude stratégique. De réorienter leur souveraineté vers ce qui compte : la terre, l’eau, la survie.
Le climat, une question de souveraineté
On leur reproche leurs ruptures diplomatiques, leur défiance vis-à-vis de certains partenaires. Mais a-t-on seulement respecté leurs alertes ? Depuis des années, ils crient famine climatique, chaos agricole, démographie en surchauffe. En réponse ? Des financements à la petite cuillère, des troupes étrangères à l’efficacité douteuse, et des sommets à huis clos où l’Afrique est invitée… à se taire.
Alors oui, ces pays ont fait des choix. Et ces choix ont un coût. Mais qui peut leur en vouloir d’avoir voulu redevenir maîtres d’un destin que le climat lui-même s’évertue à leur arracher ?
Il faudra bien, un jour, lire l’histoire autrement. Voir dans ces ruptures non pas des caprices politiques, mais des tentatives — désespérées parfois, courageuses souvent — de tenir tête à une tragédie globale qui les frappe de plein fouet.
Le Sahel ne plie pas. Il résiste. À sa manière. Et les États qu’on croyait faillis sont debout, seuls peut-être, mais lucides. Car ils savent, mieux que quiconque, que le climat n’est pas qu’une question de degrés. C’est une question de souveraineté.
Chiencoro Diarra
En savoir plus sur Sahel Tribune
Subscribe to get the latest posts sent to your email.