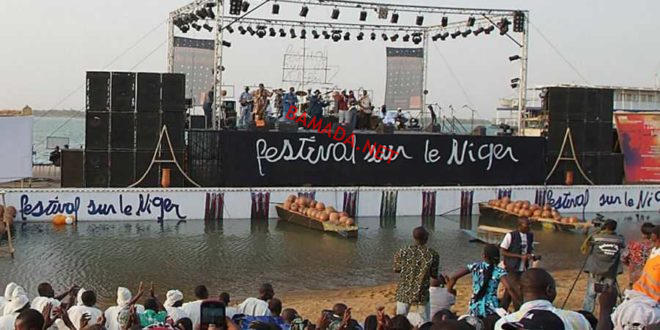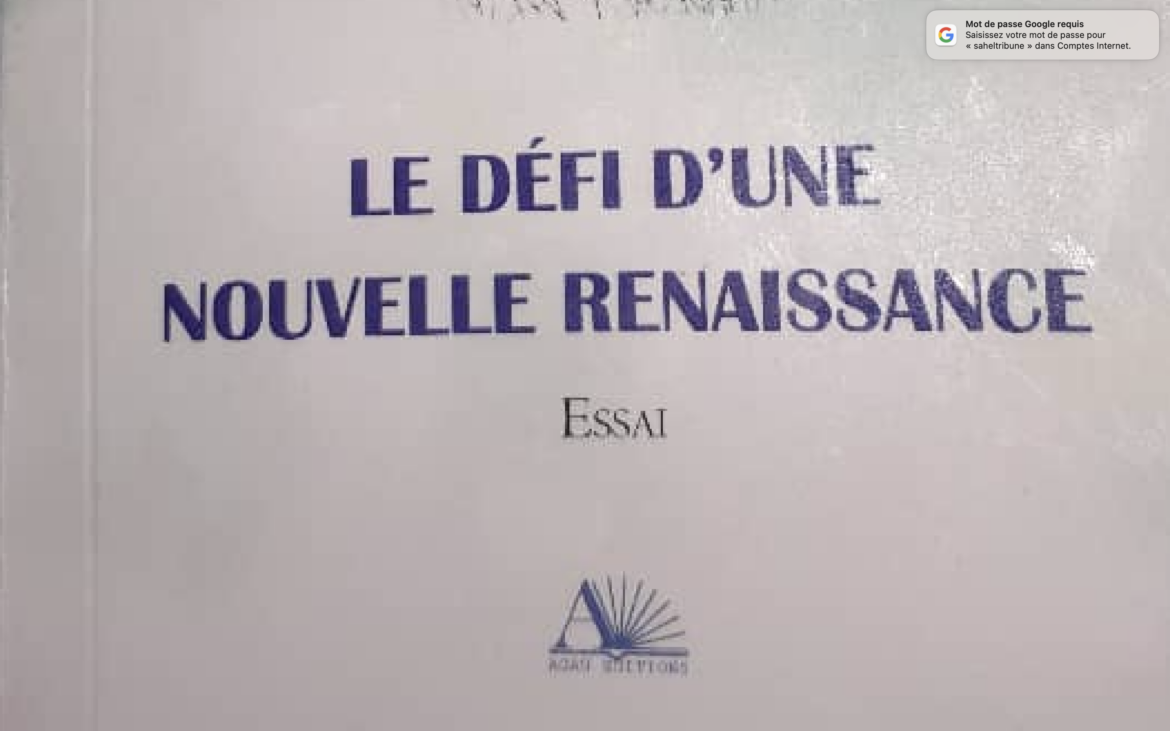Le Mali franchit une nouvelle étape dans l’exploitation du lithium avec la cession totale du projet Goulamina à Ganfeng Lithium. Ce transfert qui marque le retrait de Léo Lithium ouvre de nouveaux défis pour la valorisation locale de cette ressource stratégique.
C’est un tournant majeur dans l’exploitation du lithium au Mali. Dans son rapport trimestriel clôturant l’année 2024, Léo Lithium annonce officiellement la cession complète de sa participation dans le projet Goulamina à la société chinoise Ganfeng Lithium. Une transaction qui redéfinit les contours du secteur minier malien, avec des implications tant sur le plan économique que stratégique.
Le 26 novembre 2024, la vente du projet Goulamina a été finalisée, permettant à Léo Lithium de percevoir une première tranche de 116,3 millions de dollars américains. « La conclusion de cette transaction marque la fin d’un chapitre pour Léo Lithium et ouvre une nouvelle ère pour l’exploitation du lithium au Mali », a déclaré Simon Hay, Président exécutif de la société.
Mais cette opération n’a pas été sans contrepartie pour l’État malien. Une taxe sur les gains en capital de 44,7 millions de dollars a été directement prélevée par Ganfeng et versée au gouvernement. Une manne financière conséquente qui pourrait contribuer au financement des projets de développement du pays.
Un secteur en pleine reconfiguration
Avec ce rachat, Ganfeng Lithium prend désormais les rênes du plus grand projet de lithium du Mali. Un pays qui s’impose progressivement comme un acteur clé dans l’industrie mondiale des batteries à lithium. L’intégration complète du site par la société chinoise met en lumière l’influence croissante de Pékin dans les ressources stratégiques africaines.
Toutefois, cette cession soulève des interrogations sur la place du Mali dans la chaîne de valeur du lithium. Si le pays dispose d’importantes réserves, il peine encore à s’affirmer comme un acteur de transformation locale. Le défi reste donc de taille : comment capter davantage de valeur ajoutée pour l’économie malienne au lieu de se limiter à l’exportation de matières premières brutes ?
En se retirant du projet Goulamina, Léo Lithium tourne la page sur une aventure industrielle qui aura été marquée par des rebondissements. « Nous nous concentrons désormais sur l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement », indique la société dans son rapport. Pour les autorités maliennes, l’enjeu est de maintenir un contrôle stratégique sur l’exploitation du lithium et d’éviter que l’expérience du projet Goulamina ne soit perçue comme un simple transfert de richesse à des multinationales étrangères.
A.D