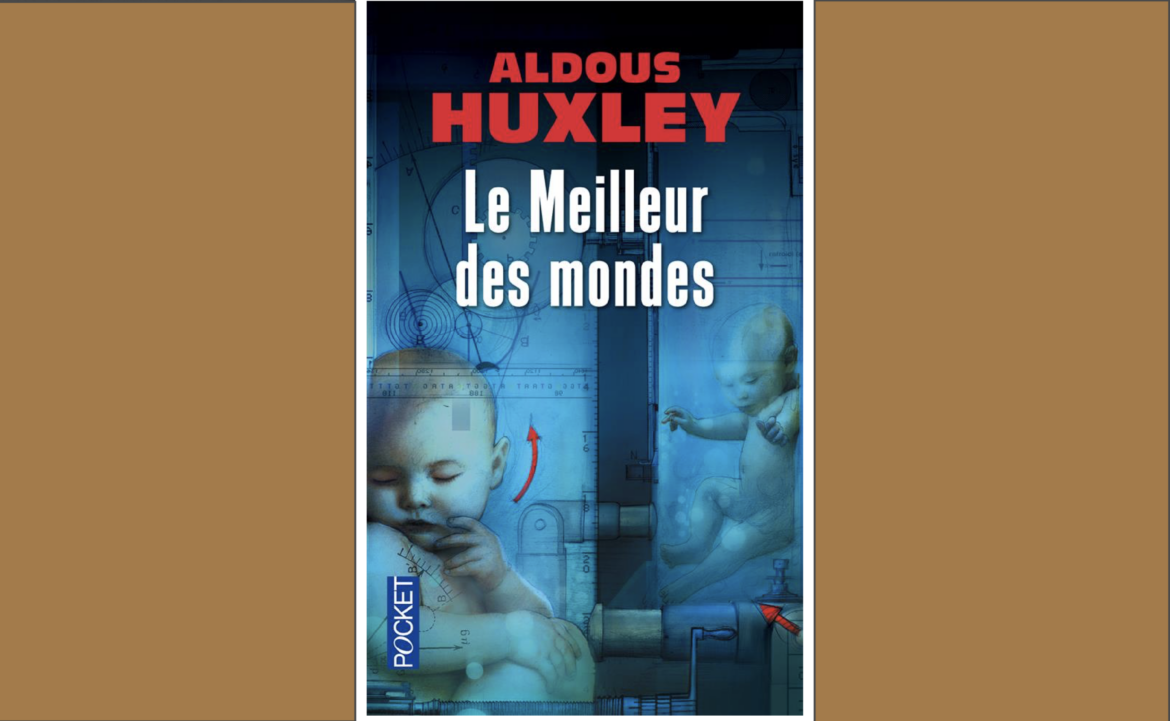Dans le cadre de son engagement à renforcer les liens avec ses ressortissants établis à l’étranger, le gouvernement malien a mis en place un cadre d’échange virtuel permettant un dialogue direct entre les autorités et la diaspora. Cette initiative, pilotée par le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, vise à mieux cerner les préoccupations des expatriés et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
La première session de ce cadre d’échange s’est tenue récemment au ministère de la Communication et de l’Économie numérique. Elle a réuni le ministre des Maliens établis à l’extérieur, Mossa Ag Attaher, ainsi que des représentants de la diaspora malienne installés dans une quinzaine de pays africains. Cette initiative vise à instaurer un dialogue constant avec les expatriés, qui jouent un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays.
Un canal de communication direct pour plus d’efficacité
Cette nouvelle plateforme répond à une volonté du gouvernement d’améliorer la communication avec les Maliens de l’extérieur, en leur offrant un espace où ils peuvent exprimer leurs préoccupations et suggestions. Pour Mossa Ag Attaher, la diaspora représente une force vive qui mérite une écoute attentive et une prise en compte de ses attentes. « Votre présence et votre engagement à l’étranger sont une richesse inestimable pour notre pays. Vos efforts, que ce soit à travers les transferts de fonds, les investissements ou votre expertise, participent activement au développement du Mali. », a-t-il affirmé.
Le ministre a également rappelé que les contributions financières des Maliens de l’extérieur dépassaient 793 milliards de FCFA en 2022, un montant largement supérieur à l’aide publique au développement reçue par le pays. Cette manne financière constitue un soutien crucial pour de nombreux ménages maliens et pour la réalisation de projets structurants.
Des préoccupations variées et prioritaires
Lors de cette première session, les échanges ont mis en lumière plusieurs préoccupations majeures de la diaspora malienne, notamment les difficultés d’orientation académique des étudiants à l’étranger, en particulier en Afrique, où l’intégration dans les systèmes éducatifs locaux demeure un défi. L’accès aux documents administratifs et de voyage, tels que les cartes biométriques et les passeports, a également été évoqué comme un frein à la mobilité et à l’employabilité des expatriés. Par ailleurs, la création d’une banque d’investissement dédiée à la diaspora, longtemps réclamée, a été soulignée comme une nécessité pour soutenir les initiatives économiques des Maliens établis hors du pays. Enfin, la question du logement s’est révélée être un enjeu central, de nombreux expatriés souhaitant investir au Mali se heurtant à des obstacles administratifs et financiers.
Face à ces doléances, le ministre a assuré que des mesures seront prises pour améliorer l’accès aux documents officiels et faciliter les démarches administratives. Il a également indiqué que certaines questions relèvent de la compétence d’autres ministères et qu’elles leur seront transmises pour un suivi efficace.
Un engagement pour l’avenir
Ce dialogue numérique s’inscrit dans une dynamique plus large visant à mieux intégrer la diaspora dans la vie nationale. Il répond également aux orientations du gouvernement en matière de renforcement des liens avec les Maliens de l’extérieur.
Mossa Ag Attaher a réaffirmé la volonté des autorités d’instaurer des échanges réguliers avec la diaspora, afin de garantir un suivi des préoccupations exprimées et de favoriser une meilleure inclusion des expatriés dans les décisions politiques et économiques du pays. Avec cette initiative, le gouvernement pose ainsi un jalon important dans sa relation avec la diaspora, démontrant une volonté accrue de dialogue et d’action pour répondre aux attentes de ses citoyens établis à l’étranger.
Ibrahim Kalifa Djitteye