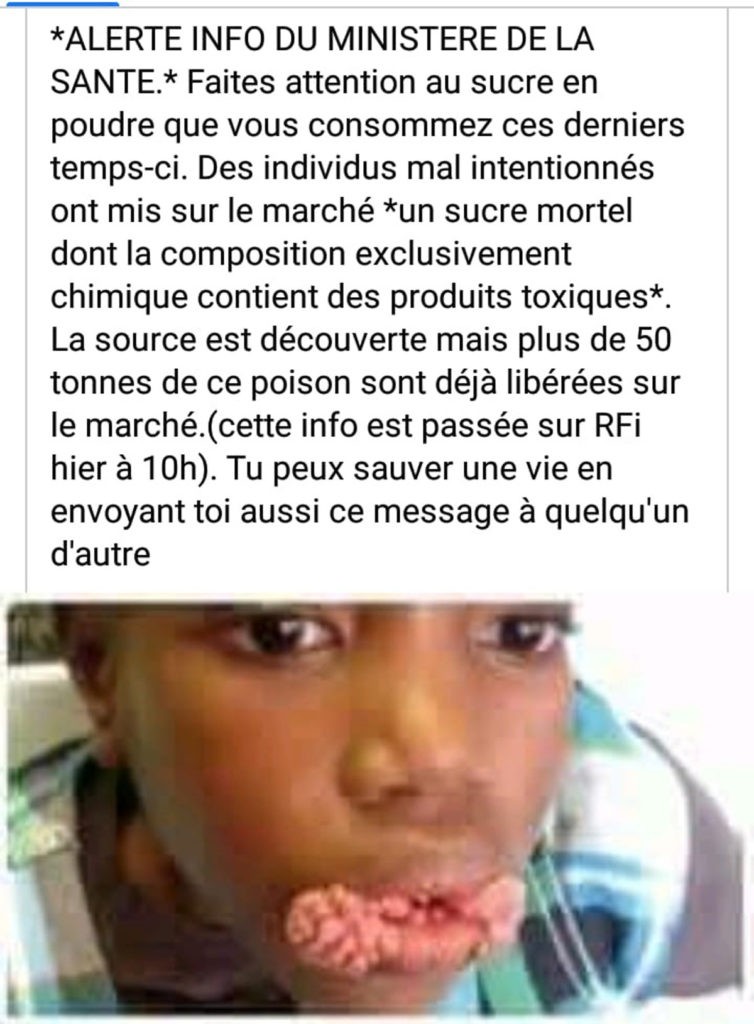Les terres agricoles, les forêts, les prairies et les savanes, les montagnes, les zones urbaines, les eaux douces et les océans, etc., constituent des écosystèmes nécessitant une restauration urgente. Des ressources naturelles victimes d’une surexploitation de l’homme. Le PNUE et la FAO exhortent l’implication de toutes les parties prenantes pour relever le défi.
Le nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), intitulé « Devenons la #GénérationRestauration : la restauration des écosystèmes pour les personnes, la nature et le climat », fait la « synthèse des preuves de l’état de dégradation des écosystèmes de la planète et détaille les avantages économiques, environnementaux et sociaux que la restauration peut apporter ».
« Des gains considérables »
Pour ses besoins, l’humanité utilise environ 1,6 fois « la quantité de services que la nature peut fournir durablement ». Face à une telle situation, les deux organisations onusiennes estiment que les efforts de conservation ne suffisent plus à « empêcher l’effondrement des écosystèmes à grande échelle et la perte de biodiversité ». Elles invitent à s’intéresser également à la restauration des écosystèmes. Un processus visant à arrêter et à renverser la dégradation. En conséquence, à assainir l’air et l’eau, à atténuer les phénomènes météorologiques extrêmes, à améliorer la santé humaine et à rétablir la biodiversité. Selon leur nouveau rapport, l’humanité pourrait utiliser près de 200 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici-2030 dans ce processus de restauration des écosystèmes terrestres.
Parc National de Mohéli
« La dégradation a déjà des effets négatifs sur le bien-être d’environ 3,2 milliards de personnes, soit 40 % de la population mondiale », ont souligné la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, et le directeur général de la FAO, QU Dongyu, dans la préface du rapport. Et d’ajouter : « Chaque année, nous perdons des services écosystémiques représentant plus de 10 % de notre production économique mondiale ».
« Des gains considérables se feront sentir » si nous inversons ces tendances. Et chaque investissement dans ce processus de restauration génère des avantages économiques considérables, indique le même rapport. Cette restauration doit permettre de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C comme s’est fixé comme objectif l’Accord de Paris.
Restaurer au moins un milliard d’hectares de terres
Le plein succès de ce processus de restauration passe par une implication réelle non seulement des entreprises, des associations, mais aussi des gouvernements. « Ce rapport explique pourquoi nous devons tous mettre notre poids dans la balance pour soutenir un effort de restauration global », ont déclaré Inger Andersen et QU Dongyu, dans la préface du rapport.
Le monde est donc invité à tenir son engagement de restaurer au moins un milliard d’hectares de terres dégradées, soit une superficie équivalente à celle de la Chine, au cours de la prochaine décennie.
F. Togola