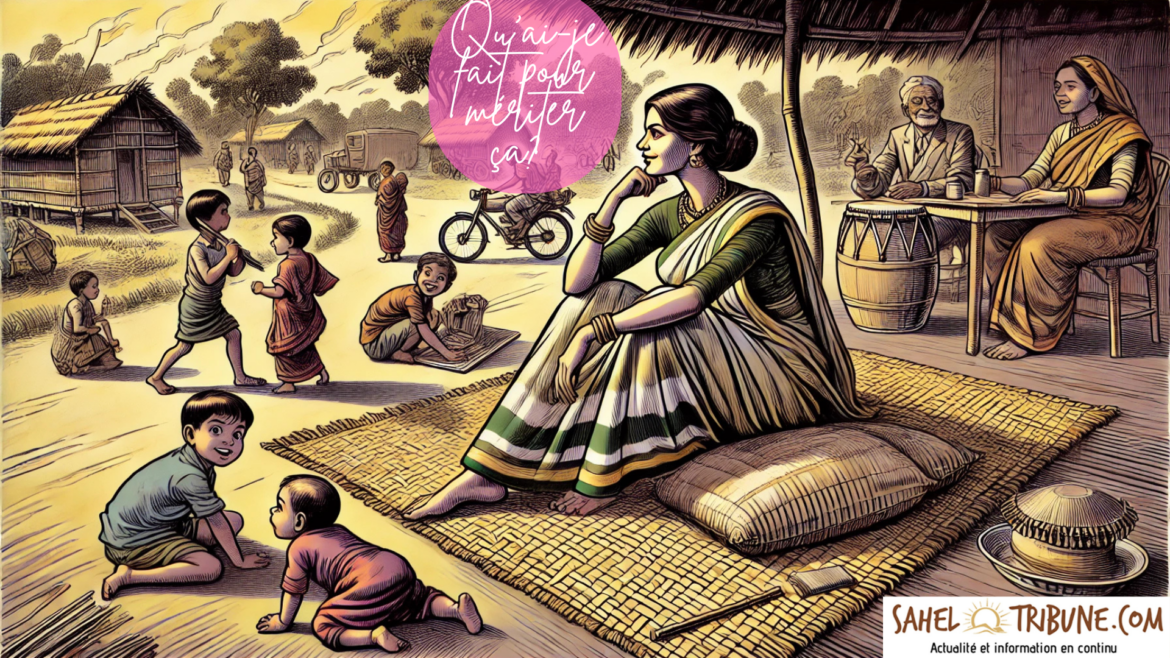Le projet de rebaptisation des lieux publics de Bamako marque une étape clé dans la valorisation de l’histoire malienne. Il rend hommage aux figures nationales et affirme la souveraineté culturelle du pays.
Bamako, la vibrante capitale du Mali, où les noms des rues, des places et des établissements publics racontent une histoire parfois oubliée, souvent effacée. Avec ce projet de décret adopté par le Conseil des Ministres, l’heure est venue de dépoussiérer nos mémoires collectives et de remettre les pendules de l’histoire à l’heure malienne. Une initiative louable ? Certes. Mais aussi une entreprise complexe, où le passé et le présent s’entrelacent dans une valse parfois chaotique.
Débaptiser pour mieux se réapproprier
Le geste symbolique de débaptiser des lieux portant des noms d’illustres inconnus ou, pire encore, des figures du colonisateur, n’est pas nouveau. Au lendemain de l’indépendance, nos dirigeants avaient déjà entrepris de rebaptiser le pays pour effacer les traces de la domination coloniale. Adieu les noms européens, bonjour les héros locaux. Mais voilà, après des décennies, certaines figures nationales se sont perdues dans l’abîme du temps. Et nous voilà face à une tâche monumentale : réhabiliter nos mémoires pour que les Maliens puissent marcher dans des rues au nom de ceux qui ont vraiment façonné leur histoire.
Mais nommer une rue, une place, ou une école, ce n’est pas seulement honorer le passé. C’est aussi baliser l’avenir. « Donner à la jeunesse des repères historiques, des références et des modèles inspirants », dit le texte. Et il a raison. Que vaut une nation sans ses héros, sans ses figures tutélaires capables d’incarner les valeurs de courage, de résilience et d’ingéniosité ? Mais attention, cela ne peut pas se résumer à des panneaux de rue ou des plaques d’inauguration. Il faut du sens, de l’émotion, et surtout, une histoire racontée.
Une question mémorielle au cœur de la souveraineté
Cette initiative s’inscrit dans une quête plus large : celle de la souveraineté. Alors que le Mali s’efforce de se redéfinir dans tous les domaines – politique, économique, culturel –, il est vital de se réapproprier son histoire. « Décoloniser les esprits », comme le dit le texte, c’est plus qu’un slogan. C’est une démarche politique forte, un acte de résistance face à l’amnésie imposée par des décennies d’influences extérieures.
Cependant, la question demeure : comment éviter que ces changements ne deviennent un simple exercice bureaucratique ? Rebaptiser des lieux est une chose, mais réanimer l’histoire et la transmettre, voilà le véritable défi. Donner des noms est un début, les remplir de sens est une autre affaire.
Des héros oubliés, mais pas perdus
Le texte rappelle également que « de nombreuses figures illustres sont tombées dans l’abîme du temps ». Une vérité cruelle. Combien d’entre nous connaissent les exploits de Modibo Keïta, Samory Touré, ou des femmes comme Aoua Keïta, militante infatigable ? Pourquoi ne pas profiter de cette initiative pour faire revivre ces figures, non seulement par des noms de rues, mais par des récits, des documentaires, des programmes scolaires ?
Et puis, il y a cette autre facette du projet : mettre à jour des dénominations déjà existantes mais jamais officialisées. Là encore, une démarche pragmatique qui montre que cette réforme n’est pas seulement tournée vers le passé, mais aussi ancrée dans la modernité. Il ne s’agit pas seulement de contempler notre histoire, mais de la faire vivre dans le quotidien des Maliens, en l’inscrivant dans les documents officiels et, pourquoi pas, dans le cœur des citoyens.
Une rue, un nom, une histoire
Ce projet de décret participe de la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation. Et c’est là tout son poids symbolique : il ne s’agit pas seulement d’une mesure administrative, mais d’un acte politique qui s’inscrit dans une vision plus large de réappropriation de notre identité. Mais attention, la symbolique, bien qu’importante, ne peut suffire. Elle doit être accompagnée d’actions concrètes pour que ces noms, ces repères, deviennent des outils d’éducation et de cohésion nationale.
Alors, Bamako, prête pour une cure de mémoire ? Si les noms changent, espérons qu’ils ne se perdent plus dans le tumulte du quotidien. Car une rue, un monument, ou une école ne sont pas qu’un simple lieu. Ils sont des chapitres d’un livre que nous devons écrire, lire et transmettre. Rebaptiser, oui, mais surtout raconter, enseigner, et, pourquoi pas, inspirer. Car au bout du compte, une nation est aussi forte que les histoires qu’elle choisit de se raconter.
Chiencoro Diarra