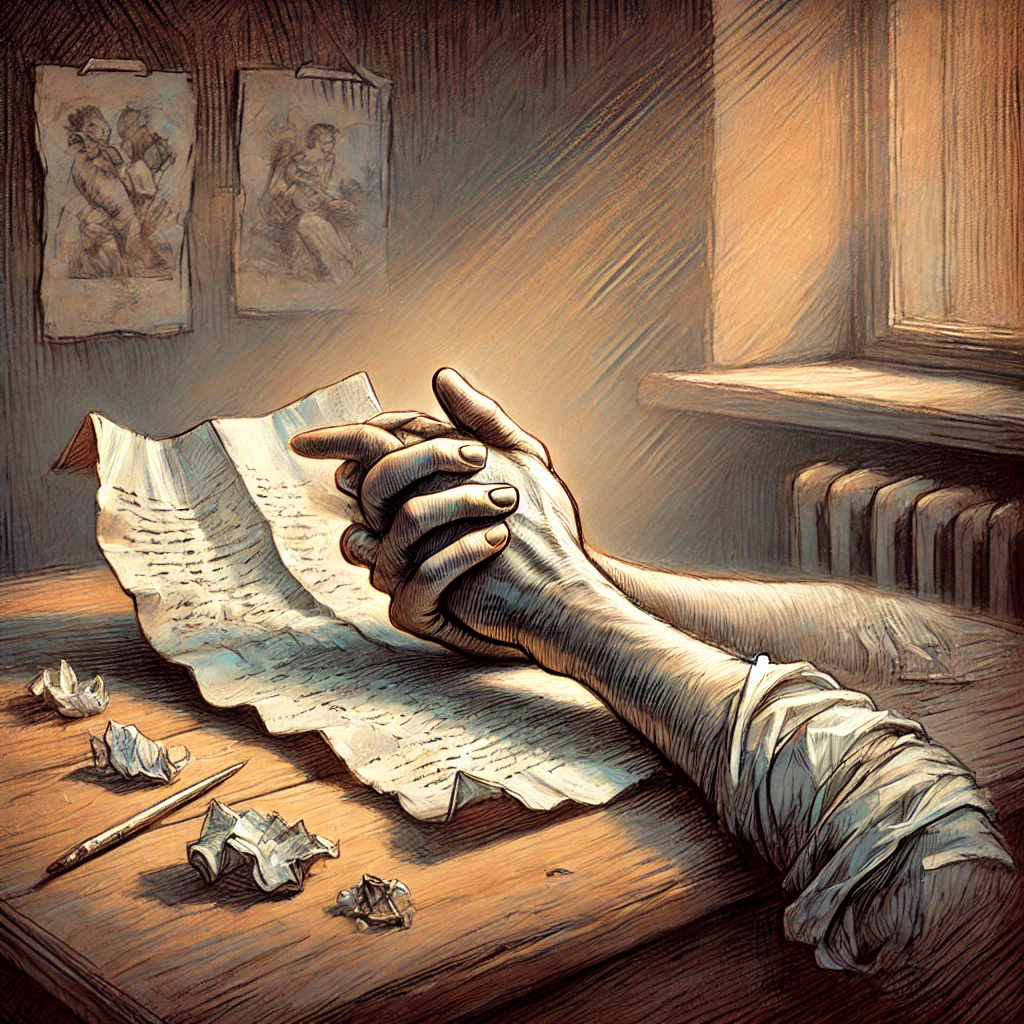Le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a récemment accueilli une conférence-débat sur le thème : « Interaction entre le Mali et la Russie dans le domaine de l’éducation ». Organisée par l’association Perspective sahélienne en collaboration avec l’agence de presse russe africain Initiative, cette rencontre visait à sensibiliser les jeunes maliens aux opportunités d’études en Russie.
Cette conférence, tenue le 21 décembre 2024, a mis en évidence le développement dynamique des relations entre le Mali et la Russie, particulièrement dans le secteur de l’éducation, un domaine clé pour l’avenir des deux nations.
Appui désintéressé de la Russie à l’Afrique
Lors de son intervention, Mikhaïl Pozdniakov, rédacteur en chef de l’agence africain Initiative, a mis en lumière le soutien constant de la Russie aux pays africains. Selon lui, ce soutien, particulièrement dans le domaine éducatif, se fait de manière désintéressée et sans visées néocoloniales.

« La Russie offre une éducation de qualité aux pays africains sans exiger quoi que ce soit en retour. Cette approche contraste fortement avec les politiques néocoloniales des nations occidentales », a-t-il affirmé.
Les atouts du système éducatif russe
Mamadou Bah, président de l’association Perspective sahélienne, a insisté sur l’urgence de refonder le système éducatif malien pour qu’il puisse répondre aux défis actuels. Il a salué les opportunités offertes par les partenariats avec la Russie dans ce domaine.
Dimitri Vlasov, chef de la section consulaire de l’ambassade de Russie au Mali, a présenté les multiples avantages du système éducatif russe. Il a souligné la diversité et la qualité des programmes proposés :
« En Russie, vous pouvez acquérir des connaissances fondamentales dans divers domaines allant des sciences techniques aux sciences humaines et médicales. Chaque année, plus de 300 000 étudiants du monde entier choisissent d’étudier en Russie, un chiffre en constante augmentation », a-t-il déclaré.
Selon lui, le système éducatif russe compte plus de 700 universités réparties sur l’ensemble du territoire, avec plus de 650 spécialités disponibles pour les cycles de licence, master, doctorat et spécialisations.
Bourses et opportunités pour les étudiants maliens
Dimitri Vlasov a également évoqué les facilités offertes aux étudiants étrangers, notamment des possibilités d’études payantes et des bourses d’études.
Pour l’année universitaire 2025-2026, la Russie prévoit d’octroyer 290 bourses aux étudiants maliens, renforçant ainsi les liens éducatifs entre les deux nations.
Cette conférence a permis de mettre en lumière les nombreuses opportunités éducatives qu’offre la Russie. Elle marque également une étape importante dans le renforcement des relations russo-maliennes dans le domaine de l’éducation, tout en encourageant les jeunes maliens à envisager des études dans ce pays aux ressources éducatives exceptionnelles.
Cheickna Coulibaly