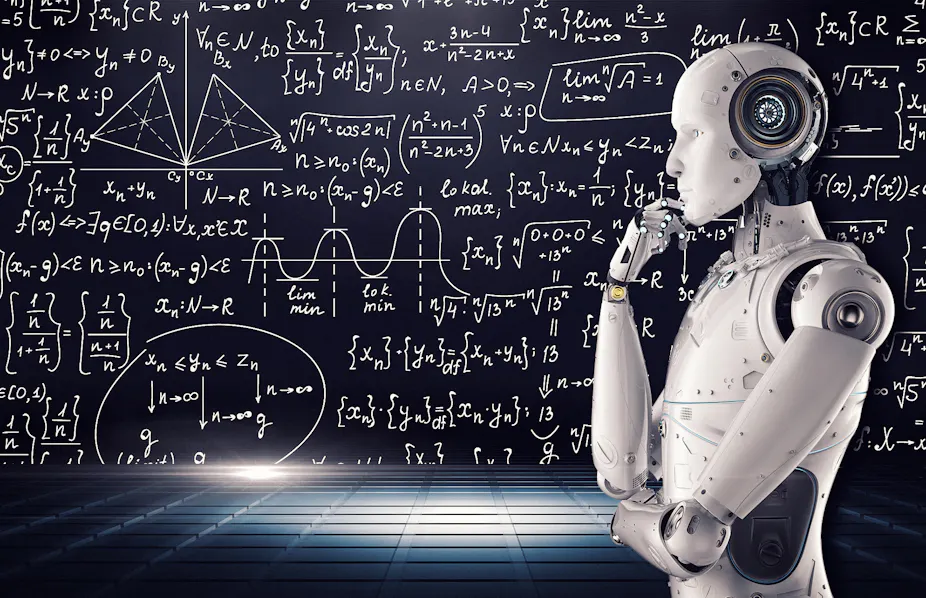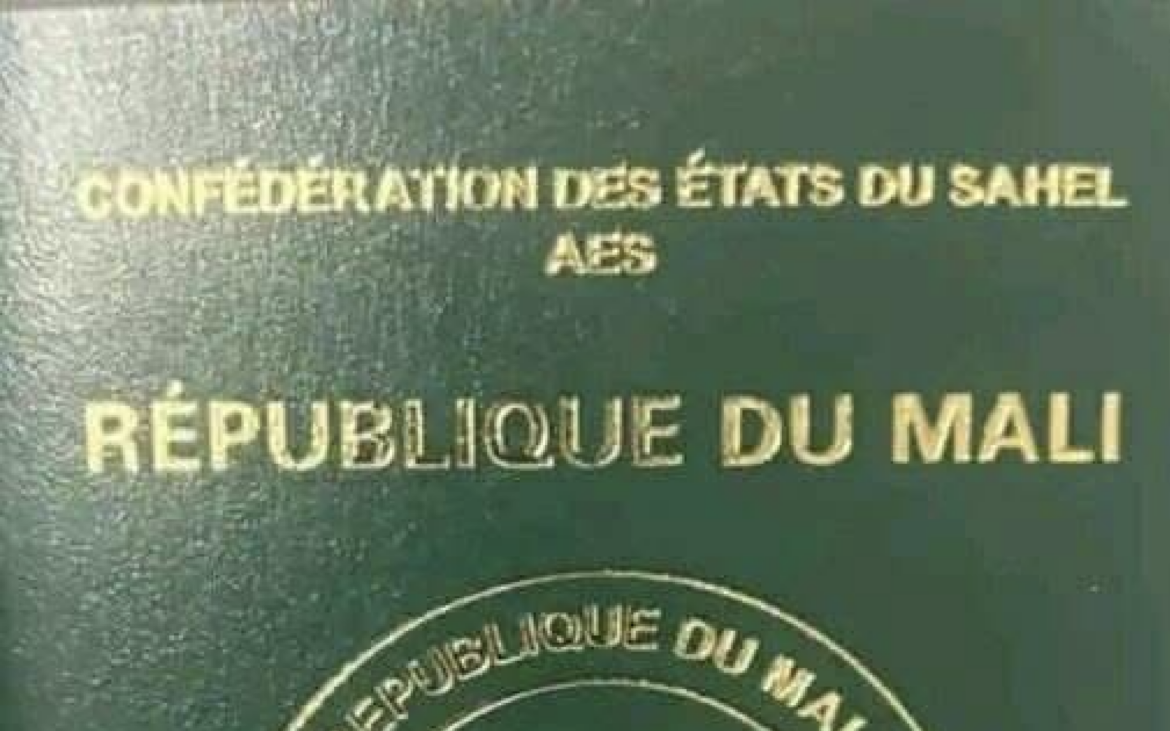Le vendredi 24 janvier 2025, le Premier ministre, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a reçu une délégation des collectivités du Mali et du Burkina Faso. Cette rencontre visait à présenter le projet de création de l’Union des Collectivités de l’AES, une initiative visant à renforcer la coopération transfrontalière et à favoriser le développement social et économique des régions concernées. Le Chef du Gouvernement a salué cette démarche et a mis l’accent sur son rôle dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans l’espace AES.
Conduite par Abdoulaye Garba Maïga, Président du Conseil régional de Mopti, la délégation comprenait également Siaka Dembélé, Président du Conseil Régional de Ségou, et Abdoulaye Bassinga, Président de l’Association des Régions du Burkina Faso. L’objectif principal de cette visite était d’exposer au Chef du gouvernement la nécessité de créer une union des collectivités de l’AES afin de mieux coordonner les efforts de développement dans l’espace commun.
Les échanges ont porté sur la coopération entre les collectivités transfrontalières et les opportunités qu’offre une telle initiative pour harmoniser les actions de développement. La délégation a sollicité l’appui du Premier ministre afin de structurer cette organisation et d’assurer sa viabilité.
Sécurité et stabilité, des enjeux majeurs
Selon les représentants des collectivités, la mise en place de cette union vise à mutualiser les ressources et les expertises pour répondre aux défis communs, notamment dans les domaines des infrastructures, de la gestion des ressources naturelles et de la sécurité. Cette approche permettrait d’attirer des financements, d’optimiser la gestion des projets et d’améliorer les conditions de vie des populations locales.
Le Premier ministre a félicité la délégation pour cette initiative, soulignant qu’une meilleure intégration des collectivités contribuera à la stabilité régionale. Il a insisté sur l’importance d’une gouvernance locale efficace pour renforcer la sécurité et favoriser une réponse coordonnée aux défis transfrontaliers, notamment la lutte contre l’insécurité et l’extrémisme violent.
Le Général Abdoulaye Maïga a rappelé que la collaboration entre les collectivités est essentielle pour la prévention des conflits et la gestion des crises locales. Il a encouragé les élus à maintenir un dialogue permanent et à impliquer activement les populations dans cette dynamique.
Un projet au service de l’intégration régionale
Le Chef du Gouvernement a également mis en avant les bénéfices d’une meilleure intégration régionale, soulignant que l’initiative pourrait devenir un modèle de coopération pour d’autres pays de la sous-région. Il a exhorté la délégation à travailler sur une feuille de route claire, définissant les objectifs, les mécanismes de fonctionnement et les partenariats possibles.
Les collectivités du Mali et du Burkina Faso, à travers cette initiative, entendent jouer un rôle clé dans le renforcement des liens entre les territoires et dans la promotion d’un développement inclusif.
Une initiative pour booster le développement local
La délégation a sollicité le soutien et les conseils du Premier ministre afin d’accélérer la mise en œuvre de cette union. Selon les membres de la délégation, la création de l’Union des Collectivités de l’AES permettra de mieux coordonner les projets de développement, de renforcer la coopération transfrontalière et de répondre aux défis communs, notamment en matière de sécurité, de gestion des ressources naturelles et de promotion des infrastructures.
Cela permettra également de stimuler le développement social et économique dans les zones frontalières et au sein de l’ensemble des collectivités de l’espace AES. Les collectivités concernées espèrent ainsi mieux mobiliser les ressources locales et internationales pour financer des projets structurants et améliorer les conditions de vie des populations.
Le Général Abdoulaye Maïga a, pour sa part, salué cette initiative et souligné l’importance de l’intégration des collectivités dans les projets de développement durable. Il a insisté sur la nécessité de veiller à ce que ces projets ne soient pas seulement des actions de développement, mais qu’ils contribuent également à améliorer la sécurité des populations, en particulier dans les zones fragiles.
Le Premier ministre a aussi rappelé que la sécurité et la défense sont au cœur de l’agenda gouvernemental et que la coopération interrégionale peut jouer un rôle déterminant pour prévenir les menaces et résoudre les problèmes locaux. Il a également encouragé la délégation à adopter une approche inclusive, intégrant toutes les parties prenantes concernées.
Vers une meilleure intégration régionale
Le Chef du Gouvernement a abordé la question de l’intégration régionale, un thème fondamental pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. Il a indiqué que les initiatives comme celle de l’Union des Collectivités de l’AES sont essentielles pour renforcer les liens entre les nations et favoriser une approche collaborative pour le développement régional.
Il a exhorté la délégation à veiller à ce que l’initiative réponde aux besoins spécifiques des populations locales et à ce qu’elle contribue activement à la construction d’un environnement stable et prospère. Il a aussi encouragé un dialogue permanent entre les collectivités pour assurer la pérennité de cette coopération.
Ibrahim K. Djitteye