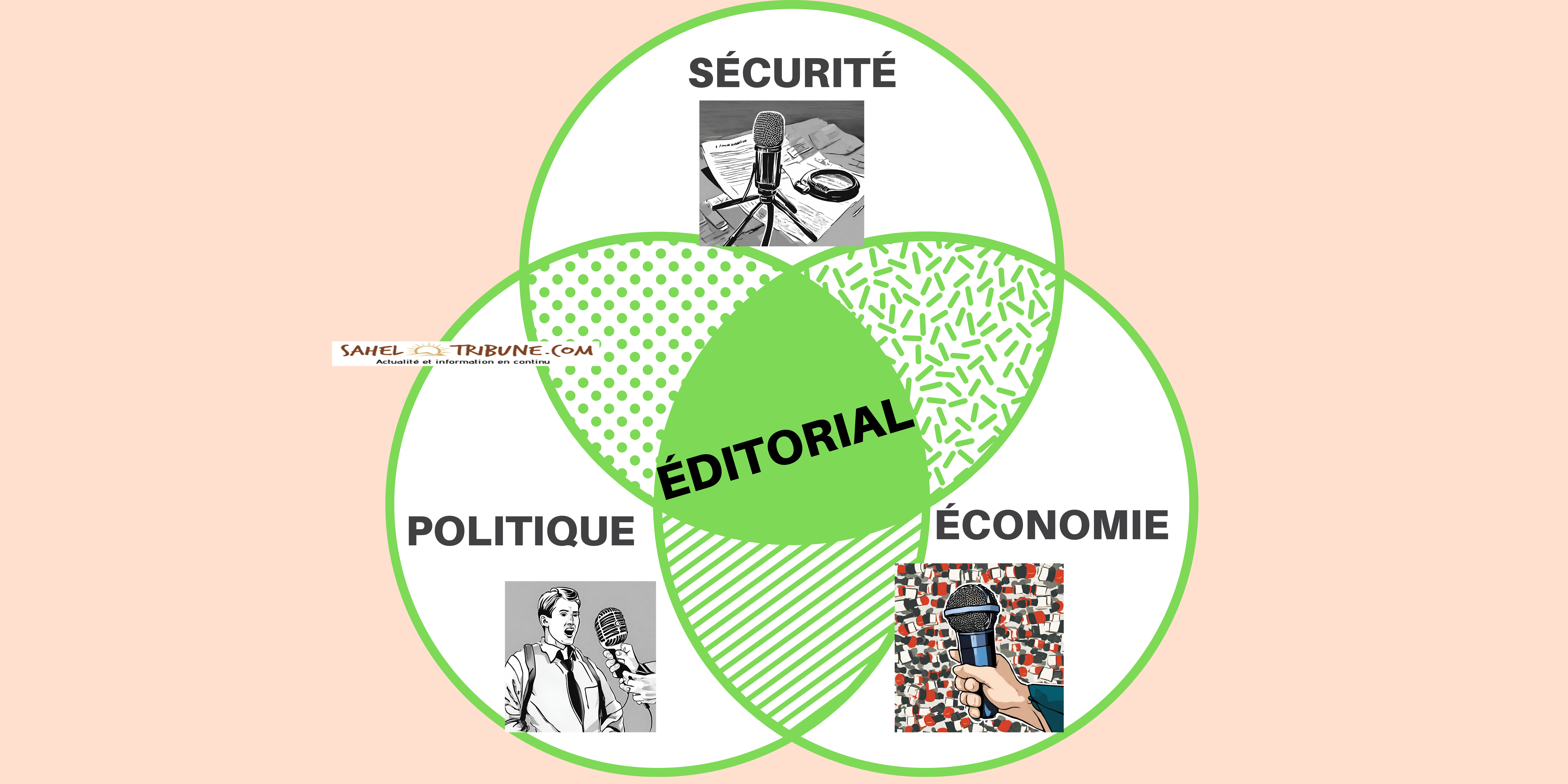Au Sahel, l’unité politique ne se décrète pas, elle se construit. Face à l’urgence sécuritaire et à la fragmentation des sociétés, l’Alliance des États du Sahel (AES) mise sur la culture comme ciment identitaire. Hymne commun, symboles partagés, dialogue interculturel… En valorisant la diversité et en forgeant une mémoire collective, le Mali, le Burkina Faso et le Niger cherchent à fonder une cohésion plus forte que les frontières héritées de la colonisation. Une stratégie à haut risque, mais peut-être la plus prometteuse pour bâtir un destin sahélien commun.
Il est de ces évidences qu’il faut rappeler avec la force d’un mantra, tant elles sont trop souvent ignorées par les ingénieries technocratiques ou étouffées par les urgences sécuritaires. Oui, la culture et l’identité collective constituent les fondations invisibles, mais ô combien décisives, de toute construction politique durable. L’Alliance des États du Sahel (AES), ce triangle de souveraineté en devenir, créée en septembre 2023, aurait tort de l’oublier au moment où elle tente d’édifier, pierre par pierre, les bases d’une intégration régionale à la fois politique, militaire et économique.
Oser une politique culturelle ambitieuse
Or, sur ce terrain, il existe une certitude. L’identité ne se décrète pas. Elle se construit. Karl-Heinz Lambertz nous le rappelle avec justesse : l’identité régionale est un passeport, non vers le repli sur soi, mais vers une mondialisation enfin maîtrisée. « Au sein des régions comme au sein de chacun d’entre nous, il n’y a pas une identité, mais des identités multiples, souvent basées sur l’affectif et la mémoire », a souligné M. Lambertz. Ce que l’Europe a laborieusement appris en soixante-dix ans d’unité à inventer, le Sahel, dans sa diversité ethnique, linguistique et mémorielle, peut réussir à l’échelle d’une génération. À la condition de dépasser les frontières héritées de la colonisation et puiser dans le socle millénaire de ce qui unit les peuples du désert et du fleuve.
Que l’on parle de la mémoire collective des empires du Sahel, des rites partagés, des langues cousines ou des mythes fondateurs, l’AES a sous ses pieds une matrice d’unité plus forte que bien des constitutions. Mais pour cela, encore faut-il oser une politique culturelle ambitieuse, décomplexée, en rupture avec l’entre-soi des cénacles ministériels. Valoriser les langues nationales, promouvoir les industries créatives, bâtir une diplomatie culturelle à l’échelle des peuples, telle doit être la feuille de route, dont l’on peut dire que la mise en œuvre a d’ores et déjà commencé avec la redénomination des espaces publics dans ces pays de l’AES.
La culture, un vecteur de développement et de cohésion sociale
Car comme le souligne Yersu Kim, l’identité n’est pas un mur, c’est un pont. Une dynamique en mouvement, un métissage revendiqué. « La culture est une sorte d’organisme vivant qui possède son dynamisme interne et qui déborde les frontières qu’il s’est fixé. Puisque le monde et la connaissance que nous en avons évoluent, la culture doit aussi changer pour répondre à ces circonstances nouvelles et changeantes », déclare-t-il. C’est pourquoi la diversité du Sahel ne doit jamais être perçue comme une menace, mais bien comme une chance. Une richesse à exploiter non pour diviser, mais pour fédérer. De Tombouctou à Niamey, de Ouagadougou à Kidal, la transculturalité est une réalité vécue. La nier serait suicidaire, la cultiver, un formidable levier d’intégration.
Stanislas Spero Adotevi le dit sans ambages : l’unité ne se bâtit pas contre les identités, mais avec elles. L’AES ne doit pas reproduire l’erreur des États-nations africains postcoloniaux, qui ont souvent cherché à imposer une identité uniforme en effaçant les différences. Au contraire, c’est dans la superposition assumée des identités peules, songhaï, touarègues, mossi ou bambaras que se dessine une intégration politique authentique, adossée à une légitimité culturelle profonde.
Enfin, comment ne pas rappeler l’intuition géniale de Jacques Berque : l’identité est une dialectique entre permanence et changement. Le Sahel ne peut se contenter d’être un musée à ciel ouvert, il doit faire de sa culture une ressource vivante, une industrie à part entière. C’est tout le sens des politiques culturelles communes à l’AES : créer de la valeur, des emplois, du sens. Faire de la culture un vecteur de développement et de cohésion sociale, et non un folklore d’apparat.
La culture comme ciment de l’unité
L’adoption d’un hymne commun par les pays de l’AES n’est pas un gadget symbolique, c’est une pierre de plus à l’édifice. Après le drapeau, la devise et le logo, c’est l’âme de cette confédération naissante qui se dessine, au son des voix sahéliennes réunies.
Le défi est immense, mais l’enjeu vital. Car une région sans récit partagé est une région livrée aux vents mauvais de la division et de la violence. En pariant sur la culture comme ciment de l’unité, les dirigeants du Sahel dessinent peut-être, à leur tour, les premières lignes d’un destin commun. Un destin que leurs peuples attendent depuis trop longtemps.
Chiencoro Diarra
En savoir plus sur Sahel Tribune
Subscribe to get the latest posts sent to your email.