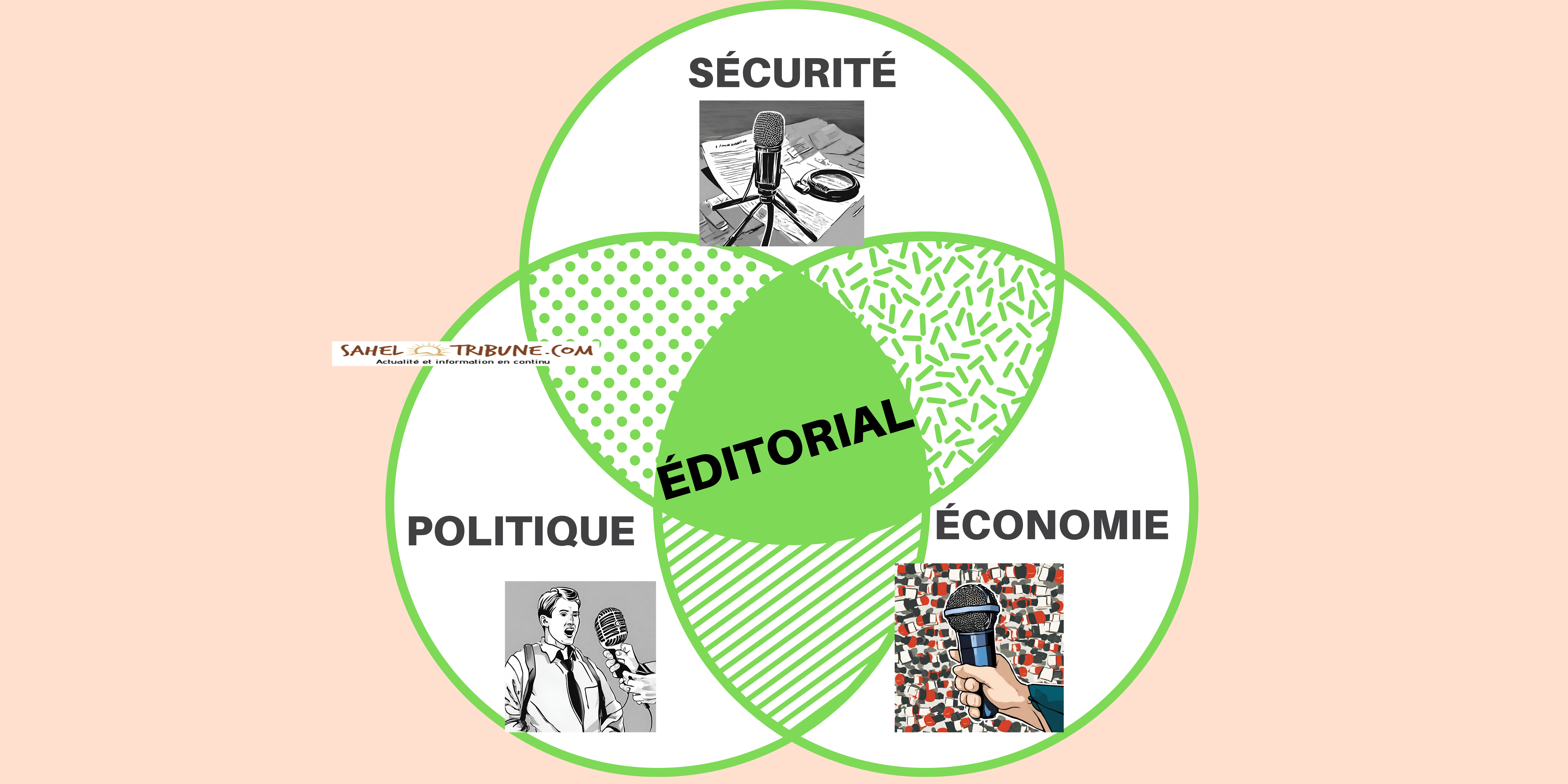Alors que le Mali mise sur l’or pour asseoir sa souveraineté économique, les groupes terroristes multiplient les attaques contre les sites miniers, transformant le métal précieux en champ de bataille stratégique.
Il ne se passe plus un mois sans que le métal jaune ne rougisse sous les cendres d’une attaque. À Naréna, à Kobé, entre Tringa-Maréna et Dialaga, les sites aurifères maliens sont devenus des lignes de front. Non plus entre compagnies rivales, mais entre un État en quête de souveraineté économique et des groupes armés qui n’ignorent rien des nerfs d’une nation.
L’or, un levier stratégique.
Ces assauts, qui ciblent machines, hommes, convois ou camps, ne sont pas isolés. Ils dessinent une stratégie terroriste d’une implacable logique : frapper là où l’or circule, là où la richesse germe, là où le pouvoir central ancre sa volonté d’indépendance. En d’autres temps, on aurait parlé de guérilla économique. Aujourd’hui, c’est une guerre asymétrique pour le contrôle des soubassements du Mali.
Car ce que ces attaques visent, c’est bien plus que des pelleteuses ou des orpailleurs chinois. Ce qu’elles visent, c’est la colonne vertébrale du projet souverainiste porté par les autorités de la Transition. Depuis l’adoption du nouveau Code minier et sa déclinaison en politique de contenu local, l’or n’est plus seulement une ressource, il est devenu un levier stratégique.
Le Mali veut son destin entre ses mains. Cela suppose que ses richesses ne soient plus siphonnées par d’obscurs contrats passés sous influence étrangère. Cela suppose aussi que le secteur minier redevienne national dans son cœur et local dans ses retombées.
Frapper l’or, c’est frapper l’État
Or que voit-on ? À peine ce cap affirmé, le secteur aurifère est frappé. Les machines de la société COVEC incendiées. Des orpailleurs civils, jeunes pour la plupart, mitraillés sur la route de Kobé. Des engins miniers réduits en cendres à Koulikoro, dans un assaut spectaculaire où les flammes disaient ce que les communiqués terroristes n’ont même plus besoin d’expliquer : frapper l’or, c’est frapper l’État.
Ce n’est pas une exception malienne. Au Burkina Faso, au Niger, dans l’ensemble du Sahel, les groupes armés appliquent la même logique. Là où il y a de l’or, il y a levier. Taxation illégale, racket, recrutement, caches d’armes… L’orpailleur devient suspect, le convoyeur devient cible, le sol devient tranchée. À Boungou, en 2019, 40 morts. Depuis, des centaines de sites ont fermé, et la terre ne nourrit plus que la peur.
Mais au Mali, cette guerre économique a une portée encore plus lourde. Car ici, le projet de refondation se joue aussi dans les mines. L’or est devenu politique. Il est devenu symbole. Et comme tout symbole, il attire la violence de ceux qui refusent l’émancipation des États.
Le feu d’une souveraineté naissante
Il serait naïf de croire que ces attaques ne visent que des installations. Elles visent une vision. Celle d’un pays qui veut se redresser par lui-même. Elles cherchent à dissuader les investisseurs locaux, à fragiliser la chaîne de valeur malienne, à décrédibiliser la promesse d’un Mali maître de ses ressources.
Et pourtant, le pari est le bon. Jamais l’or n’a autant compté dans l’équation économique nationale. Jamais le cours mondial n’a été aussi sensible aux réformes nationales. Le monde regarde. Les marchés suivent. Les ennemis frappent.
Face à cela, l’État malien devra faire plus que sécuriser les sites. Il devra renforcer l’ancrage local du secteur, impliquer les communautés riveraines, militariser les chaînes logistiques critiques si nécessaire, et surtout maintenir intacte la volonté politique.
L’or malien brûle, oui. Mais c’est aussi le feu d’une souveraineté naissante. Et comme toute souveraineté, elle se conquiert sous les balles, mais aussi dans les bureaux, les lois, les bilans. Le combat ne fait que commencer.
Chiencoro Diarra