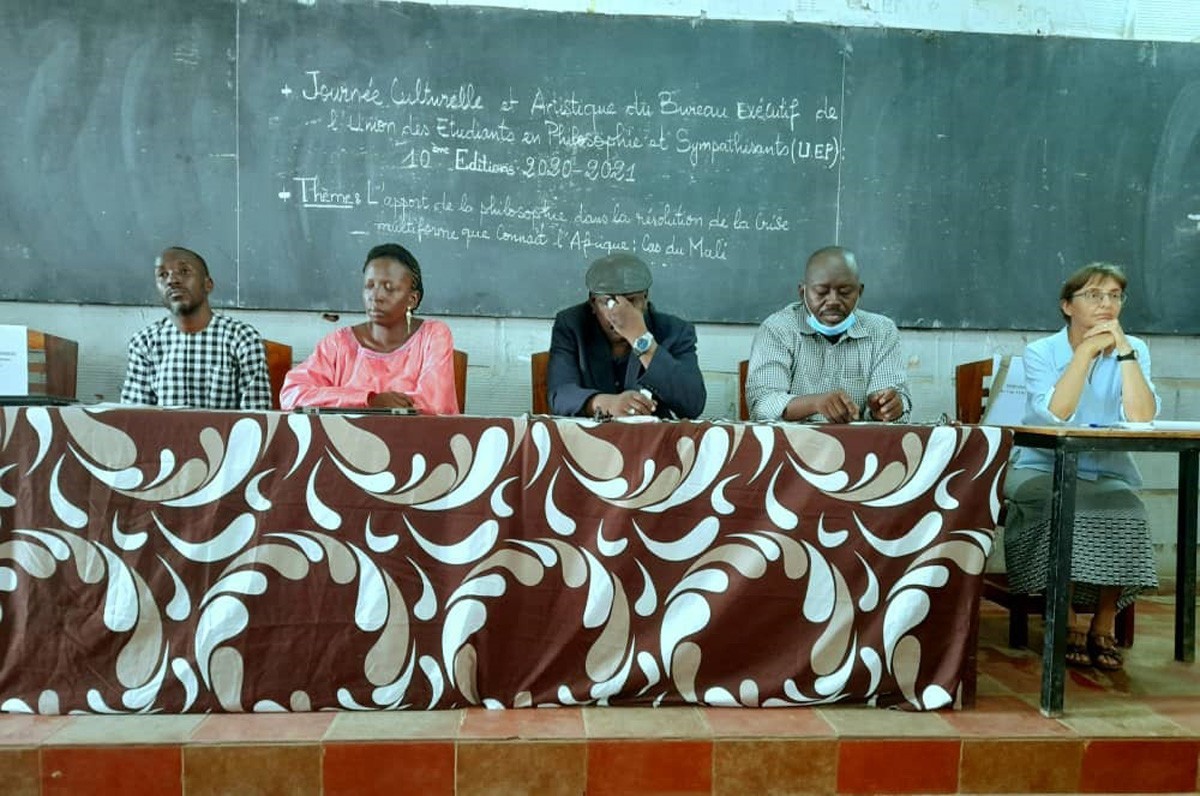Sur initiative des présidents français et ivoiriens, une Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) a été inaugurée, jeudi 10 juin 2021, en Côte d’Ivoire. Un pôle « d’expertise et de compétence » qui voit le jour alors que les attaques se multiplient dans ce pays.
Au Sahel, les attaques terroristes sont récurrentes. Le dernier cas de figure est l’attaque de Solhan au Burkina Faso, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Une attaque qui a fait une centaine de morts civils. Au Mali aussi bien qu’au Niger, au Tchad ou encore en Mauritanie, pour ne citer que ces pays qui forment le G5 Sahel, les attaques terroristes coupent le sommeil aux populations.
Un pôle d’expertise et de compétence régional
À partir de ces pays, les terroristes étendent de plus en plus leurs menaces sur des pays voisins, notamment la Côte d’Ivoire, où plusieurs attaques sont enregistrées ces derniers temps. En mars 2021, des terroristes venus du Burkina Faso ont tué deux (2) soldats ivoiriens et blessé quatre (4) autres à Kafolo. Au cours d’une deuxième attaque, le même jour, un gendarme a été tué et un autre blessé à Kolobougou, à la frontière avec le Burkina Faso. Le 7 juin dernier, toujours à la frontière avec le Burkina Faso, dans la localité de Tougbo, des hommes armés ont perpétré une attaque qui a fait un mort parmi les soldats ivoiriens. Sur l’axe Tehinio-Togolokaye, également à la frontière burkinabè, une patrouille des forces armées ivoiriennes a subi une attaque, le 12 juin dernier, qui a fait trois (3) morts et quatre (4) blessés dans les rangs des soldats ivoiriens.
Cette contagion de l’Afrique de l’Ouest appelle les décideurs politiques ainsi que leurs partenaires, à revoir leur copie en matière de stratégie de lutte contre le terrorisme. L’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) a été inaugurée en Côte d’Ivoire, le jeudi dernier. Une initiative du président français, Emmanuel Macron, et de celui de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, depuis 2017, en vue de contribuer à la lutte contre le terrorisme. « L’AILCT doit devenir un pôle d’expertise et de compétence régional de la lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité de nos États et de la sécurité de nos populations », a indiqué, lors de l’inauguration de cette Académie, le président ivoirien.
Agir en amont
Cette Académie constitue un centre d’entraînement des unités d’intervention spéciales ainsi qu’un institut de recherche stratégique. C’est aussi un pôle de formation des magistrats ainsi que des douaniers et des personnels des administrations pénitentiaires.
Cette initiative, dans une Afrique de l’Ouest déstabilisé par le terrorisme, est salutaire. Seulement on se demanderait quel pourrait être son impact réel. Nous savons qu’au Mali, malgré la présence de l’École de maintien de la paix, Alioune Blondin Bèye, qui forme également des stagiaires ; de la Minusma, qui accompagne le Mali sur plusieurs plans, notamment de sécurité et de développement ; de l’EUTM, qui accompagne ce pays dans la formation des forces armées, voire de Barkhane, le Mali reste caractérisé par une insécurité multidimensionnelle qui ne cesse de s’étendre.
Bien avant son inauguration, quelque 500 stagiaires avaient été formés par cette Académie depuis 2017. Ce nombre peut sembler insignifiant, mais malgré cette formation, d’autres attaques ont eu lieu dans ce pays côtier d’Afrique de l’Ouest, après celle de Grand-Bassam, en 2016.
Dans la lutte contre l’insécurité dans cette région de l’Afrique, les initiatives ne manquent pas. Mais l’un des véritables problèmes est le moment choisi pour ces initiatives. Des mesures qui devraient venir généralement en amont arrivent en aval. Un mort n’a plus besoin de médecin, pour paraphraser un adage bien connu.
Changer d’approche
La situation que traverse la Côte d’Ivoire aujourd’hui, avec des attaques sporadiques, l’international Crisis group avait bien alerté sur la situation depuis décembre 2019. « En Afrique de l’Ouest, les mouvements jihadistes armés avancent comme le désert, du nord vers le sud. Leur influence au Burkina Faso inquiète de plus en plus les États côtiers d’Afrique de l’Ouest. Si quasiment aucune attaque n’a eu lieu dans ces pays, leurs dirigeants craignent que les militants utilisent le Burkina Faso comme une rampe de lancement pour des opérations plus au sud », pouvait-on lire dans le Briefing N° 149 de Crisis group/Afrique.
Dans cette lutte contre le terrorisme, tout se passe comme si ces États africains et leurs partenaires ne vivent que pour trouver des solutions aux nouvelles tactiques des groupes terroristes pendant que ceux-ci évolueraient déjà vers un niveau supérieur. Il serait plus raisonnable de travailler à la prévention. Pour réussir sur ce chantier, ces « États failli » doivent veiller non seulement à lutter contre la corruption, la mauvaise gouvernance, mais aussi à une meilleure coordination des efforts afin de mieux contrôler les frontières qui sont devenues poreuses, et à une amélioration significative du partage des renseignements.
Fousseni Togola
Source : maliweb.net