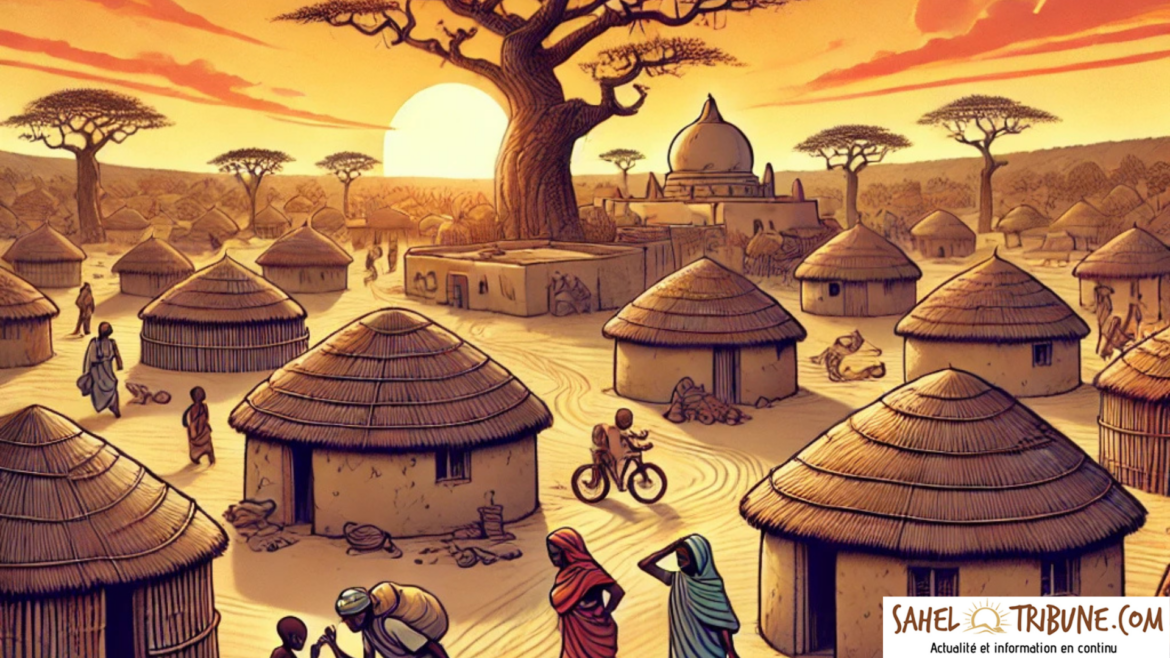L’augmentation de la participation de l’État au capital de la BNDA, portée à 77,33 %, est une étape stratégique pour renforcer la souveraineté économique et soutenir le développement agricole au Mali.
La décision prise en Conseil des ministres du mercredi dernier d’adopter un décret augmentant la participation de l’État au capital social de la Banque Nationale de développement agricole (BNDA) est bien plus qu’un simple acte administratif. C’est une vision stratégique et ambitieuse pour l’avenir économique et agricole du Mali. Cet acte touche aux fondements mêmes de l’indépendance économique et de la souveraineté nationale.
Une institution au cœur du développement agricole
Créée en 1981, la BNDA n’est pas une banque comme les autres. Elle est un outil essentiel au développement rural et agricole, contribuant à financer des projets qui structurent les bases de l’économie malienne. Agriculture, pêche, agro-industrie, habitat rural : chaque secteur soutenu par la BNDA constitue une brique dans l’édifice de la sécurité alimentaire et de l’emploi.
Le Mali, pays à vocation agro-sylvo-pastorale, s’appuie sur ces secteurs pour assurer la résilience de ses populations face aux défis climatiques, économiques et géopolitiques. En renforçant sa participation au capital de la BNDA, l’État malien ne fait pas qu’acquérir des actions : il affirme une volonté claire de maîtriser les leviers stratégiques du développement agricole et rural.
La souveraineté économique au cœur de la démarche
Dans un contexte mondial marqué par des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et par la dépendance accrue de nombreux pays envers des institutions financières internationales, le rachat des parts de la Société allemande d’Investissement et de Développement (21,43 %) et du Crédit coopératif (9,70 %) constitue une étape décisive pour la souveraineté économique du Mali.
Avec désormais 77,33 % du capital détenu par l’État, la BNDA devient un outil presque entièrement national. Ce choix stratégique permet de réduire les influences extérieures sur les décisions financières et opérationnelles de la banque, garantissant ainsi que ses priorités restent alignées sur les besoins réels du peuple malien.
Un geste fort pour la résilience agricole
En prenant ce contrôle majoritaire, l’État malien montre sa détermination à bâtir une résilience agricole durable. La BNDA, en tant que levier de financement, peut jouer un rôle décisif dans l’accroissement de la production locale, la transformation des matières premières sur place, et l’autonomisation des acteurs ruraux.
Cette démarche permet également de lutter contre l’exode rural en créant des opportunités économiques dans les zones rurales. Chaque projet financé est une promesse d’emploi, une avancée vers la sécurité alimentaire et une contribution à la stabilité sociale.
Cependant, ce choix s’accompagne de responsabilités. L’État devra veiller à ce que la gestion de la BNDA reste exemplaire et transparente. L’augmentation de la participation publique ne doit pas se traduire par une inefficacité administrative ou une politisation des décisions économiques.
La réussite de cette démarche dépendra aussi de la capacité de l’État à mobiliser les ressources nécessaires pour libérer pleinement son capital. Cela implique de faire preuve de rigueur budgétaire et de prioriser les investissements stratégiques.
Une souveraineté réaffirmée
Cette décision du gouvernement Abdoulaye Maïga s’inscrit dans une vision plus large : celle d’un Mali souverain, autonome et tourné vers l’avenir. En consolidant sa participation dans la BNDA, l’État ne fait pas qu’assurer la pérennité de l’institution. Il pose les bases d’une nouvelle ère pour le secteur agricole, où les richesses du pays serviront en priorité le bien-être de ses citoyens.
Il s’agit là d’une leçon précieuse pour d’autres secteurs stratégiques de l’économie malienne. À l’heure où le monde redéfinit ses priorités face aux crises multiples, le Mali démontre qu’il est possible de reprendre le contrôle de ses instruments économiques et de tracer sa propre voie vers le développement.
Chiencoro Diarra