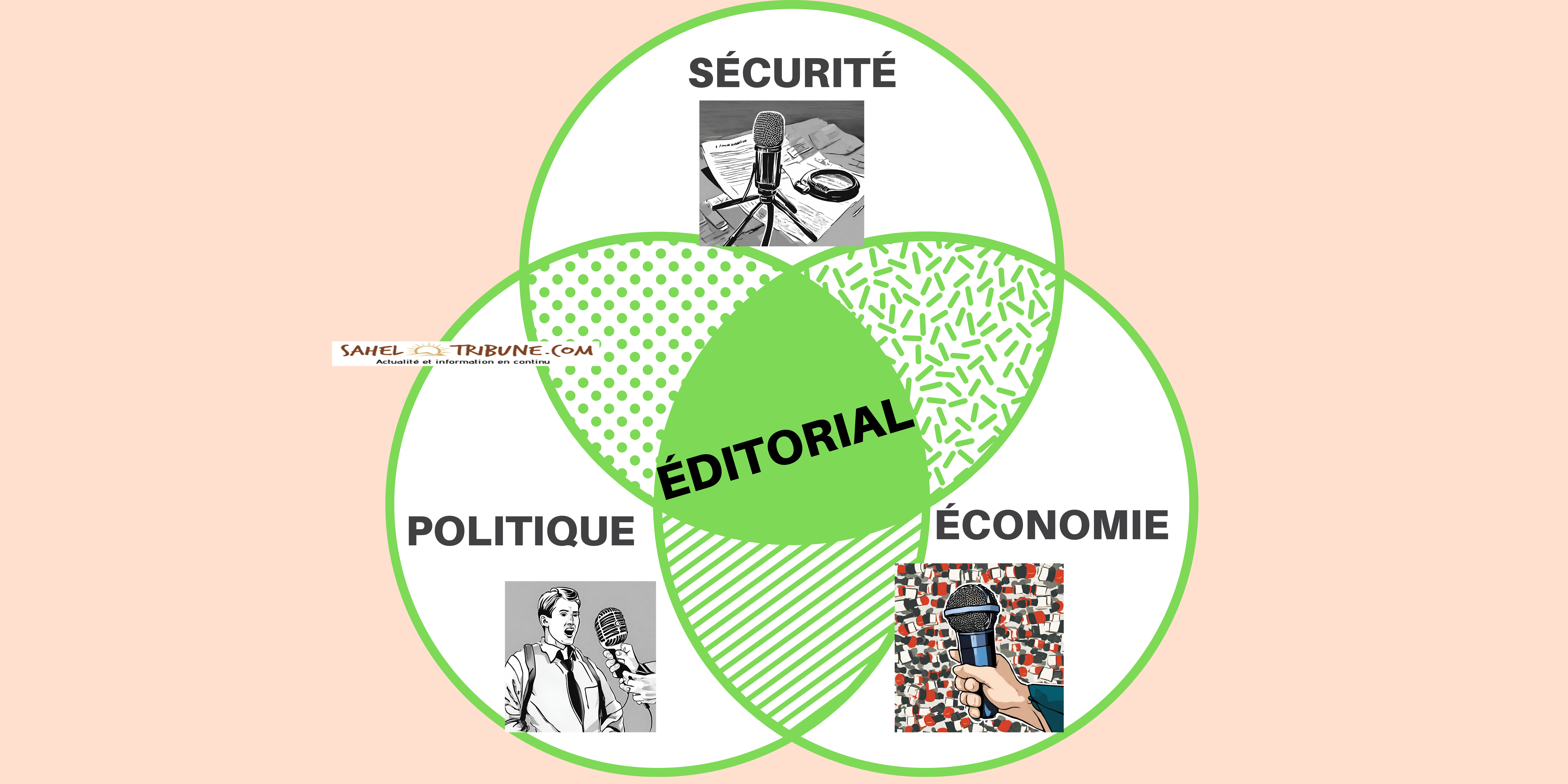Sous les apparences féériques de l’union entre figures publiques se dessinent les contours d’une transformation plus profonde : celle du mariage comme instrument de reproduction sociale dans les sociétés africaines contemporaines. Entre tradition, religion et capital symbolique, la noce devient une scène où se rejouent, entre deux hashtags, les vieilles luttes de classe sous un jour nouveau.
C’est un de ces événements mi-sociétaux, mi-spectaculaires, dont seule l’ère TikTok pouvait accoucher à Bamako ou Ouaga. À la croisée du buzz numérique, du mythe religieux et du clinquant social, le récent mariage de la tiktokeuse burkinabè Djamila Diallo avec Seid Chérif Hamed Tidjane Haïdara, fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, a provoqué une onde virale qui, au-delà des écrans, révèle un vrai tournant dans l’évolution des codes du mariage en Afrique de l’Ouest.
2022, le mariage de Belebele Chizy
Sur les réseaux sociaux, on s’est précipité à en faire un énième conte moderne. La belle influenceuse aux centaines de milliers d’abonnés, tombée dans les bras du très convoité héritier d’un des plus puissants dignitaires religieux du Mali. Une histoire cousue d’or et d’algorithmes, où la religion flirte avec la notoriété, et où le sentiment amoureux — ce vieux rêve romantique — semble tenu à distance. Mais est-ce si simple ?
Comme toujours, dans cette région où le sacré épouse souvent l’apparat, chacun y est allé de son hypothèse. Mariage d’argent ? Alliance d’influence ? Arrangement spirituel ? L’amour, le vrai, celui des poètes et des ballades peules, est curieusement absent de ces scénarios en circulation.
Et pourtant… ce phénomène n’est pas nouveau. Déjà en 2022, le mariage de Belebele Chizy, tiktokeuse notoire, avec le milliardaire malien Mohamed Samassékou avait fait couler autant de thé que de pixels. Là aussi, on prédisait une union éphémère, une passade de luxe vouée à l’échec. Trois ans plus tard, le couple vit toujours… à Dubaï.
Ce qui interroge ici, ce n’est pas tant le choix de ces jeunes femmes que le regard que la société pose sur leurs unions. Ce regard, souvent condescendant, parfois méprisant, trahit une crispation face à la transformation profonde des modèles matrimoniaux dans nos sociétés sahéliennes. Il soulève une question fondamentale : l’amour est-il encore la boussole du mariage dans nos sociétés modernes ?
Le mariage comme miroir des mutations sociales
Longtemps, le mariage au Mali n’a jamais été affaire de cœur uniquement. Il était d’abord un pacte social, une alliance entre familles, clans, castes. Il répondait à des logiques communautaires, parfois mystiques, souvent économiques. Le Senkoli, le dambé, les noix de colas, la dot… Autant de rituels fondateurs d’un contrat aux multiples dimensions, bien au-delà des sentiments.
La modernité, avec l’école, la migration, l’éducation des filles et l’urbanisation, a introduit une autre grammaire : celle de la liberté de choix, du mariage d’amour, de la quête individuelle. Le Code des personnes et de la famille de 2011 au Mali, bien qu’amendé sous pression religieuse, en est un reflet partiel. À Bamako, les jeunes femmes repoussent l’âge du mariage, refusent les unions imposées, et revendiquent leur droit à choisir — ou à refuser — un conjoint.
Mais voici qu’émerge une troisième voie, une nouvelle hybridation. Dans cette société désormais connectée, hypermédiatisée, marquée par le culte du prestige et la circulation virale de l’image, le mariage devient aussi une affaire de positionnement social. On ne se marie plus seulement par amour ni par obligation, mais aussi — parfois surtout — pour ce que l’union symbolise en termes de notoriété, de rang, d’ancrage dans l’élite économique ou religieuse.
Ce n’est pas là un phénomène marginal. Il traduit le retour en force des hiérarchies sociales de Platon (aucun lien de mariage ne doit exister entre membres de classe différente pour éviter de souiller les classes) ou encore des sociétés africaines traditionnelles où le mariage entre certains groupes sociaux était interdit, dans un monde où l’argent impose ses codes, où l’aristocratie religieuse côtoie les influenceuses, et où l’élite économique redéfinit le « désirabilité matrimoniale ».
Retour au prestige, consentement inclus
Faut-il pour autant y voir une régression ? Pas si sûr. Contrairement à la « société fermée » d’hier, où le mariage était imposé sans appel, cette nouvelle « société capitalistique » conserve une forme de consentement. Les protagonistes se choisissent, même si c’est sur d’autres critères que l’amour au sens romantique. Le riche choisit la belle. L’influenceuse choisit le rang. L’union est libre, mais stratégiquement orientée.
Cela n’étonnera personne dans une région où l’Islam confrérique, le prestige lignager et la visibilité numérique se combinent pour façonner de nouveaux codes. Où l’alliance d’un fils de Haïdara avec une star du TikTok burkinabè est perçue, par certains, comme une passerelle entre deux mondes que tout opposait. Pour d’autres, elle est surtout le symptôme d’un nouvel âge du mariage malien : plus individualisé, plus spectaculaire, mais toujours structurant.
Le « génération » et la « corruption »
On pourrait convoquer ici la logique aristotélicienne de la génération, de l’accroissement et de la corruption des êtres. Tout naît, croît, vieillit, et meurt. Le mariage malien, comme institution sociale, suit cette logique circulaire. Le « mariage fermé » fut corrompu par le contact colonial ; le « mariage ouvert » est aujourd’hui corrompu par le « capitalisme sentimental ». Une nouvelle ère commence, où le sacré cède le pas à l’affichage, et où les valeurs se marchandisent.
Mais comme le rappelait Karl Popper dans sa critique des historicismes fermés, rien n’est inévitable. La corruption d’une institution n’est pas sa mort. À condition d’en repenser les fondements.
Le défi de la stabilité
Reste la question centrale : ces mariages dureront-ils ? Le buzz médiatique se transforme-t-il en socle solide pour bâtir une famille ? On l’ignore. Mais le cas de Belebele Chizy, toujours dans son foyer à Dubaï, invite à relativiser les prophéties de divorce précipité. L’histoire du mariage africain est faite de surprises, de résiliences, d’alliances qui défient les pronostics.
Ce que ces mariages « influents » révèlent, ce n’est pas tant une crise de l’amour qu’un déplacement de ses fondations. L’amour est toujours là, mais il a changé de grammaire. On ne tombe plus amoureux d’un visage ou d’une voix. On tombe amoureux d’un destin projeté, d’un capital relationnel, d’un nom à particule spirituelle.
À terme, si cette dynamique se généralise, elle pourrait nous conduire à des mariages contractuels, temporaires, de convenance, à l’image des sociétés occidentales. Où l’union devient un pacte, une fusion-acquisition, avec date de péremption intégrée.
Mais au Mali, l’histoire nous enseigne une chose : les sociétés africaines savent digérer les influences exogènes sans perdre leur âme. À condition de ne pas céder à la dictature du clinquant. À condition de se souvenir que l’amour, ce n’est ni TikTok ni le prestige : c’est le projet à deux. Tout le reste n’est que décor.
Chiencoro Diarra
En savoir plus sur Sahel Tribune
Subscribe to get the latest posts sent to your email.